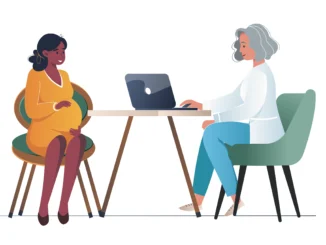Que faire en cas d’avis négatif sur internet ?
La qualité de soignant ne constitue pas une protection et, comme pour toute autre prestation de service, les patients peuvent publier leur avis sur le professionnel de santé. Il s’agit en effet d’un droit basé sur la liberté d’expression, droit fondamental consacré par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si les systèmes de notations et d’avis sur les professionnels de santé peuvent choquer et laisser penser à une tendance au « consumérisme médical », ils ne sont pas en soi illégaux. À partir du moment où un professionnel de santé est référencé sur internet, ses patients ont le droit de donner leur avis sur ses prestations. Comme tous les métiers de contact avec le public, les sages-femmes, surtout lorsqu’elles exercent en libéral, peuvent faire l’objet d’avis négatifs sur internet. Si un commentaire négatif peut être extrêmement blessant, il n’est pas pour autant illégal. La plupart d’entre eux sont même parfaitement légaux, tant qu’ils restent dans les limites de la liberté d’expression. La loi encadre donc strictement ces limites à la liberté d’expression et le premier réflexe à avoir face à un avis négatif sur internet est d’exercer son droit de réponse. En revanche, il peut être nécessaire de demander le retrait de l’avis et/ou d’agir en justice si l’avis est illégal et porte préjudice au professionnel de santé. Il faut donc faire la distinction entre les avis illégaux et les avis légaux. À noter tout de suite : certaines compagnies d’assurance proposent, en option en général, dans le contrat d’assurance responsabilité civile ou de protection juridique, une assistance en cas d’atteinte à la réputation par la diffusion d’informations sur internet (en mettant par exemple en œuvre des prestations de nettoyage ou de noyage de ces informations). En cas de problème, il peut donc être intéressant dans un premier...