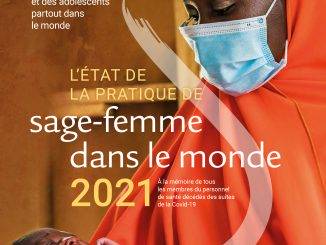Alimentation des bébés : le poids du marketing
Ciblage en ligne non réglementé et invasif, réseaux de conseils et lignes d’assistance parrainés, promotions, cadeaux, formation des professionnels de santé… Tous les moyens semblent bons pour les fabricants de substituts de lait maternel, à en croire une récente enquête menée conjointement par l’Unicef et l’OMS. Il faut dire que l’industrie du lait artificiel pèse près de 50 milliards d’euros chaque année (55 milliards de dollars). Une raison pour ne pas s’embarrasser de règles éthiques, morales ou commerciales ? C’est tout au moins une raison suffisante pour dépenser chaque année entre 3 et 4 milliards d’euros, rien qu’en marketing. « Les messages que les parents et les agents de santé reçoivent sont souvent trompeurs, sans fondement scientifique et contraires au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel – un accord de santé publique historique adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1981 pour protéger les mères contre les pratiques commerciales agressives des fabricants d’aliments pour nourrissons », dénoncent les auteurs du rapport. AÏKIDO MÉTHODOLOGIQUE Les spécialistes ont mené l’enquête dans huit pays de niveaux socio-économiques variés : Afrique du Sud, Maroc, Nigéria, Bangladesh, Vietnam, Chine, Mexique et Royaume-Uni. Les auteurs les ont choisis pour être assez représentatifs de leur zone géographique et également assez divers en matière de taux d’allaitement au sein. Entre août 2019 et avril 2021, ils y ont interrogé 8500 parents et femmes enceintes ainsi que 300 professionnels de santé, notamment des pédiatres, gynécologues, sages-femmes. Pour traiter leurs données, dans une sorte d’aïkido méthodologique, ils ont détourné les armes de l’ennemi. Ils ont mis en place des techniques propres au marketing commercial et aux enquêtes de consommateurs, ce qui n’était quasiment jamais arrivé dans le cadre d’une recherche en santé publique. Les auteurs ont par exemple conduit une centaine de « focus groups ». Privilégié par les professionnels du marketing, cet outil s’apparente à des réunions […]