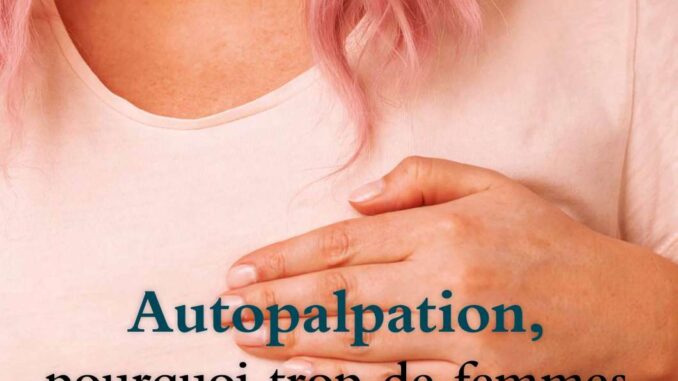
Depuis quand encourage-t-on les femmes à s’auto-inspecter les seins ? La première documentation
encourageant l’autoexamen des seins daterait de 1947, lorsque le docteur A. M. Popma et la Idaho Division of the American Cancer Society ont pris l’initiative de créer et diffuser un film sur le protocole d’autopalpation à travers tous les États-Unis.
Les médecins avaient alors mesuré que dans 98 % des cas de cancer du sein, les patientes elles-mêmes s’étaient rendu compte que quelque chose n’allait pas, ce constat les poussant à consulter. La pratique de l’autoexamen de la poitrine a ainsi été considérée comme l’une des techniques permettant de détecter précocement un éventuel cancer du sein.
Depuis, des campagnes pédagogiques et de prévention autour de l’autopalpation ont vu le jour dans de nombreux pays, mettant en lumière cette pratique. L’apparition d’Octobre rose, en 1985, aux États-Unis, a également largement contribué à la prévention autour des cancers du sein. Ce concept est arrivé en France en 1994, célébrant ses 30 ans cette année. L’objectif de cette campagne mondiale est de dépister précocement les cancers du sein afin d’améliorer le taux de survie à la maladie.
État des lieux de l’autopalpation en France
Près d’une femme sur huit est touchée par un cancer du sein au cours de sa vie. Et la France comporte le plus haut taux d’incidence de cancer du sein au monde, avec 105,4 cas recensés pour 100 000 personnes en 2022, selon l’Organisation mondiale de la santé. Mais également un taux de mortalité bas, avec 15,8 décès sur 100 000 personnes.
Cette prévalence particulièrement importante du nombre de cancers devrait aller dans le sens d’une prévention poussée auprès des femmes, notamment en ce qui concerne l’autoexamen des seins. Pourtant, selon un sondage Ifop et Gleeden mené en 2021, 60 % des Françaises ne savent pas comment faire une autopalpation mammaire, 13 % n’en ont jamais entendu parler, 33 % ne le font jamais (contre 41 % en 1994) et 44 % n’a jamais fait d’examen de dépistage du cancer du sein (contre 66 % en 1998). Selon les recommandations institutionnelles, l’autoexamen des seins doit être pratiqué une fois par mois dès l’âge de 20 ans ou au plus tard dès 25 ans, à un moment du cycle menstruel où les seins sont souples et non douloureux, idéalement quatre à sept jours après les règles.
Le protocole repose sur l’observation des seins et du mamelon (à la recherche de crevasses, fossettes, plis, peau d’orange ou peau qui pèle), la palpation des seins et des aires ganglionnaires en partant de l’aisselle et en effectuant de petits cercles sur le sein (à la recherche de grosseur ou de callosité anormale), et la pression des mamelons (à la recherche d’un écoulement de liquide ou de sang). Cette pratique, qui prend approximativement trois minutes à la patiente pour les deux seins, se fait le bras levé, en palpant avec l’index, le majeur et l’annulaire de la main opposée.
Cet autoexamen ne remplace cependant pas l’examen clinique recommandé chaque année à partir de 25 ans, à faire chez une sage-femme, un gynécologue ou un médecin généraliste. Si une anomalie est détectée, une mammographie est prescrite. Ces trois techniques de dépistage sont complémentaires.



