
À quel âge avez-vous décidé de devenir sage-femme ?
C’est une blague bien sûr, mais j’aime à penser que j’ai prononcé ces deux mots en sortant du ventre de ma mère : « Sage-femme ». Et même si ce n’est pas tout à fait vrai, ce n’est pas tout à fait faux non plus. Très tôt, j’ai voulu m’occuper des bébés, j’étais attirée par les ventres ronds. À 20 ans, j’ai assisté à la naissance de ma sœur, une expérience merveilleuse qui venait confirmer ma vocation. Plus tard, la naissance de ma nièce m’a révélé, à l’inverse, la violence possible autour d’un accouchement. Ces deux expériences opposées ont marqué mon parcours et fondé ma vision du métier.
Après avoir obtenu mon bac, j’ai réussi le concours d’entrée en 1991 et commencé mes études à Marseille puis, je les ai poursuivies à Lomme, près de Lille. Ça faisait drôle quand je disais que j’étais à l’école de sages-femmes de Lomme ! J’ai été diplômée en 1995 et j’ai exercé ensuite dans différentes maternités, petites et grandes, afin d’acquérir de l’expérience. J’ai toujours eu à cœur de respecter les souhaits des patientes et de valoriser la physiologie des naissances, souvent moins enseignée que les pathologies.
Vous travaillez désormais exclusivement en libéral ?
Oui, j’ai commencé… sous les cocotiers de Polynésie en 2000. J’y avais suivi mon ex-mari militaire et, pour travailler, j’ai accepté de remplacer une sage-femme libérale partie en congé maternité et j’ai adoré ! C’est à Mamao qu’est né mon premier enfant, sous péridurale très dosée, moi incapable de bouger, de l’ocytocine, de grosses anomalies du rythme fœtal, une dilatation du col au doigt, une expression utérine, des forceps et une épisiotomie… Ma fille était sauvée, c’est l’essentiel, mais pour moi les suites ont été très difficiles et longues. Je me suis dit « Plus jamais ça, ni pour moi, ni pour les autres », le vécu psychologique de la mère est essentiel.
J’ai découvert une approche plus humaine lors de la naissance de mon deuxième enfant. J’étais soutenue par ma collègue Stéphanie, à qui j’avais fait promettre de m’accompagner à domicile pour mon troisième, ce qui fut chose faite en 2010 : un pur bonheur. « Pourquoi je ne l’ai-je pas fait dès mon premier ? », me suis-je dit. Stéphanie a choisi d’arrêter cet accompagnement quelques années plus tard, pour se consacrer entièrement à sa passion pour le yoga. Après mes deux ans passés en Polynésie française, j’ai réintégré mon poste de sage-femme salariée à l’hôpital. Le libéral me titillait, alors j’ai accepté une collaboration avec une collègue pour faire des visites à domicile (monitoring, suites de couches), ainsi que de la préparation à la naissance classique et de la rééducation périnéale. Je me préparais doucement à changer de statut.
J’ai également rencontré sur mon chemin Laurence, une sage-femme extraordinaire. Sitôt sortie de l’école, Laurence avait choisi d’accompagner les couples dans leur projet d’accouchement à domicile (AAD). C’était pour elle aussi une vocation qu’elle a assurée et assumée pendant près de trente ans. Quand elle est tombée malade, elle a souhaité que quelqu’un reprenne le flambeau, c’est ce que je fais aujourd’hui. Elle est malheureusement décédée en 2019.

Vous n’aimez pas parler de « griefs » contre l’hôpital, plutôt de « constats ». Quels sont-ils ?
La fermeture des maternités a eu des répercussions nombreuses qui vont au-delà de la seule santé : un allongement des trajets pour enfanter, avec le risque de naissances inopinées sur la route ou à domicile ; un retard possible de prise en charge en cas de complications ; du stress et de l’anxiété pour les femmes enceintes ; des inégalités territoriales d’accès aux soins et aussi des suppressions de postes de sages-femmes, d’aides-soignants et de médecins. Dans les grandes structures hospitalières, l’organisation et la charge de travail laissent peu de place pour un suivi individualisé. Une sage-femme en salle doit souvent accompagner plusieurs femmes en même temps, ce qui rend difficile une présence continue auprès de chacune. C’est ainsi qu’on nous a formées : évoluer dans un cadre très médicalisé, où l’on fait au mieux avec les protocoles et les moyens donnés. Et il faut le reconnaître, les conditions de travail ne permettent pas toujours de faire autrement. Pour ma part, j’ai beaucoup appris à l’hôpital sur le plan technique. J’y ai fait de précieuses rencontres, ce fut une expérience humaine et professionnelle riche. Mais l’hôpital est aussi un système très exigeant, qui peut user les soignants comme les patientes. C’est ce qui m’a donné envie de retrouver ailleurs un accompagnement plus humain, plus individualisé.
Quelles sont les raisons principales du désir d’accoucher « physiologiquement » ?
De plus en plus de femmes souhaitent vivre un accouchement physiologique afin de reprendre le contrôle de leur corps et de leur expérience de la naissance. Elles cherchent à éviter les interventions médicales non nécessaires, à suivre leur instinct et les rythmes naturels, à créer un environnement intime et respectueux favorisant le bien-être hormonal, le lien mère-enfant, ainsi qu’une meilleure récupération. Cette démarche, motivée par une quête d’autonomie et de sens, peut découler d’expériences passées traumatisantes, comme d’un premier accouchement mal vécu. Il peut s’agir aussi d’un désir profond de confiance en soi. Parallèlement, certains professionnels de santé soutiennent également ce retour à des pratiques plus naturelles pour des raisons médicales, humaines et sociales.
Quand vous êtes passée en libéral, vous avez accompagné tout de suite les AAD ?
Pas tout de suite. Les AAD demandent une disponibilité totale, difficilement compatible avec une vie de famille, notamment lorsque l’on a de jeunes enfants. On peut vous appeler à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. C’’est tout bonnement impossible sans le soutien indéfectible d’un partenaire ou de grands parents, prêts à prendre en charge toute la maisonnée en votre absence. J’ai donc patienté et attendu que mes enfants soient plus grands et plus autonomes. Quand toute la famille a été prête, je me suis lancée ! Cela fait maintenant cinq ans que j’accompagne les AAD dans le Var, à une dizaine de kilomètres de Toulon, en direction de Nice. J’interviens beaucoup dans l’arrière-pays, notamment le Haut-Var qui est un véritable désert médical.

Est-ce le manque d’infrastructures qui explique la demande d’AAD des couples ?
Oui et non. Les femmes perçoivent l’accouchement comme un processus naturel et critiquent les interventions médicales imposées sans réel consentement. Pourquoi ? Parce qu’elles entraînent un sentiment de perte de contrôle et de dépossession de leur corps. Le problème central est donc le manque d’écoute et de respect de leurs choix. L’accompagnement consiste à rappeler que l’accouchement est leur corps, leur choix, qu’elles doivent recevoir une information claire sur les bénéfices, les risques et les alternatives, afin de décider librement et en confiance. La loi Kouchner du 4 mars 2002, pierre angulaire du droit de la santé en France, renforce les droits des patients (dignité, vie privée, secret médical) et la transparence du système de santé. Elle a été enrichie par des lois ultérieures (2004, 2005, 2009, 2016) concernant l’autonomie, la fin de vie, la sécurité et la participation des usagers. Dans le cadre médical, notamment lors de l’accouchement, elle consacre le droit au consentement éclairé et au refus de soins, les professionnels devant respecter la volonté du patient tout en assurant son suivi et son information. Elle introduit aussi la notion de « personne de confiance ». Lors d’un accouchement à domicile, j’ai moi-même l’obligation de fournir une information claire et complète sur les risques, les conditions de transfert, le matériel utilisé, etc. La loi protège la liberté de choix de la patiente (lieu d’accouchement, accompagnement, etc.) tant qu’elle est compatible avec la sécurité et la légalité.

L’expérience des accouchements à domicile est-elle positive ?
Extrêmement positive. Au début de mes accompagnements, j’arrivais avec tout l’arsenal des protocoles hospitaliers, puis peu à peu, je les ai « détricotés » pour m’adapter à chaque couple. Ça m’a pris du temps, je me suis formée en physiologie de l’accouchement, en d’autres préparations à la naissance plus pratiques pour soulager la douleur et faire participer le partenaire à 100 %. J’ai appris de chaque patiente, de chaque partenaire, de chaque bébé. Je ne perds jamais de vue la notion d’urgence et je reste régulièrement informée des manœuvres obstétricales, en cas de siège inopiné, dystocie des épaules, hémorragie de la délivrance, procidence du cordon. À l’hôpital, à l’école, on nous a appris à guetter les clignotants oranges ou rouges qui peuvent faire dériver vers la pathologie. À domicile, on se recentre sur la physiologie, le cocktail hormonal, ne pas déranger, ne pas perturber, on prend ses distances avec des procédures qui sont souvent pensées pour organiser, planifier. Pour autant, il reste essentiel de surveiller les alertes tout au long de la grossesse, essentiel également de savoir poser des limites face à des projets déraisonnables. Chaque naissance est unique. En cinq ans, j’ai accompagné environ 141 naissances à domicile, pas une n’a ressemblé à une autre ! J’aimerais en écrire un livre. D’ailleurs je tiens un carnet de bord des accouchements, également des transferts que j’ai accompagnés.
Tout s’est toujours bien passé ?
Jusqu’à maintenant, oui. Bien sûr, il y a eu des transferts non urgents à l’hôpital, lors du travail ou après une naissance. Ou encore, suite à des décisions pendant la grossesse qui font que ce n’est plus de l’ordre de la physiologie. Une sage-femme à domicile doit garder en tête que le risque zéro n’existe pas… La situation peut évoluer et la vigilance doit rester totale. Je pense, pour ma part, que je suis encore plus vigilante que lors de mes gardes en structure… Je reste à l’affût du moindre détail, de la moindre alerte. La plupart des transferts que j’ai accompagnés concernaient des accouchements longs et épuisants nécessitant une péridurale ou une aide médicamenteuse, des liquides teintés ou des anomalies du rythme fœtal. Malgré ces situations, les mamans et les bébés allaient bien. La médicalisation est un soutien précieux et j’en appelle à une meilleure collaboration entre sages-femmes et équipes hospitalières pour le bien-être des familles.
Y a-t-il des spécificités quand on prépare un accouchement à domicile ?
La préparation à la naissance est similaire en structure ou à domicile si le couple souhaite un accouchement naturel, conformément aux recommandations de la HAS (2017) qui privilégient le respect de la physiologie et l’absence d’interventions médicales systématiques. Je privilégie une préparation à la naissance individuelle, que j’adapte à chaque couple et famille que j’accompagne. Je fais beaucoup participer le co-parent. Le jour J, ce sera lui le « roc » qui fera en sorte que la bulle dans laquelle s’est mise sa partenaire ne soit pas perturbée, afin qu’elle puisse continuer à sécréter les bonnes hormones. Ce sera lui ou elle « la personne de confiance » de la loi Kouchner, lui ou elle qui répondra aux questions de l’équipe, ou à moi si c’est un AAD. Si une femme seule souhaite accoucher à domicile, je lui demande si quelqu’un de sa famille ou de ses amis peut être présent pour l’accompagner pendant la grossesse, mais également pendant l’accouchement et les suites de couches. Après la naissance, je reste au minimum deux heures et reviens dans les douze heures, mais il est important qu’un proche soit présent entre-temps. Les familles sont informées des conditions et du budget de l’accouchement à domicile. Je travaille avec une deuxième personne (doula ou autre accompagnante de confiance) et idéalement avec une deuxième sage-femme pour pallier à une éventuelle urgence, bien que cela soit difficile à organiser dans le Var.
La seule différence concernant la préparation à la naissance à domicile, c’est d’abord un premier échange sur les motivations profondes, une information sur l’organisation de l’AAD en région PACA, un rappel des conditions, l’établissement d’un climat de confiance et de coopération entre le couple et la sage-femme, la possibilité de se connecter et d’adhérer à différentes associations, l’affirmation et la réaffirmation à tout moment de la grossesse et de l’accouchement qu’on est toujours sur du bas risque. Certaines manœuvres et certains actes peuvent être discutés en fonction de l’urgence. J’informe sur le matériel mis à disposition, ainsi que sur le besoin de l’avis d’un autre professionnel de santé. Nous abordons la question d’un éventuel transfert. Il faut veiller à l’instauration d’une bonne communication entre les équipes ville-hôpital, avec ouverture de dossier dans une maternité de proximité. C’est important que le couple soit préparé à cette éventualité et qu’il ne la refuse pas. Cela permet de dédramatiser l’idée d’aller à l’hôpital, mon but n’étant pas de la faire accoucher absolument à domicile mais que, quelle que soit l’issue, d’un accouchement physiologique à une césarienne en structure, le vécu physique, psychologique et mental soient bons pour toutes les personnes concernées.
Quel est le rôle de la doula ?
Une doula est une accompagnante non médicale qui soutient les familles pendant la maternité. Sans cadre légal ni diplôme officiel, elle est formée dans des structures privées et rémunérée par les parents. Son rôle consiste à écouter et rassurer la future mère, à accompagner le projet de naissance, à offrir un soutien émotionnel, physique et pratique pendant la grossesse, l’accouchement (si accepté par l’équipe médicale) et le post-partum. Elle contribue aussi à renforcer le lien parental et à prévenir les difficultés comme le baby-blues. C’est évidemment ce que je fais également et nous sommes extrêmement complémentaires pour le confort et le bien-être de cette parentalité naissante. La doula ne fait aucun acte médical, elle n’en a pas le droit et, dans le cadre d’un AAD, elle attend mon arrivée pour rentrer au domicile du couple.

Il y a environ 80 sages femmes qui font des AAD en France, pourquoi si peu quand 35 % des femmes souhaiteraient accoucher à la maison (cf. encadré) ?
Le développement de l’AAD est souvent freiné par la méfiance institutionnelle, par des normes médicales très centrées sur l’hôpital, mais surtout par les problèmes d’assurance. Depuis la loi du 4 mars 2002, toute sage-femme doit impérativement souscrire une « responsabilité civile professionnelle » couvrant l’ensemble de ses actes professionnels. Les assureurs français refusent d’assurer les AAD. Cette exclusion, de plus en plus répandue, rend la recherche d’un contrat adapté particulièrement délicate. Le tarif est prohibitif, entre 19 000 et 25 000 euros voire plus par an. Cela dépasse la rémunération moyenne d’une sage-femme ! L’assurance est donc inaccessible. En Suède et en Belgique, l’assurance coûte environ 1 000 euros, ce qui est largement gérable !
En cas de problème, l’Ordre national des sages-femmes (Onsf) vous soutiendrait-il ?
C’est difficile de répondre à cette question. L’Ordre ne promeut pas l’AAD isolé, mais plaide pour une organisation structurée, respectueuse de la sécurité des femmes tout en tenant compte de leur liberté de choix et des attentes sociétales. J’ai pu mesurer, au fil de mon parcours, combien l’Ordre des sages-femmes savait être présent et soutenant lorsque cela était nécessaire. Je lui en suis reconnaissante. L’Ordre encourage plutôt le développement d’alternatives sécurisées aux maternités traditionnelles, notamment les unités physiologiques permettant une prise en charge moins médicalisée au sein des maternités. Ou encore les maisons de naissances, lieux autonomes gérés par des sages-femmes, pour les grossesses à bas risque, mais structurés avec des protocoles de sécurité et de transfert. Il appelle à concilier sécurité, autonomie et respect du projet de naissance des femmes.
Une sage-femme à domicile a une obligation de moyens, mais pas de résultat c’est bien cela ?
Oui. Je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires avec compétence, conscience, prudence et rapidité pour atteindre un objectif sans garantir le succès final, selon les règles de la déontologie. À jour des connaissances et dans les limites de mes compétences, je me dois d’évaluer les risques (pathologies, distances, situation sociale…), être équipée de matériel d’urgence, disposer d’un plan de transfert vers une maternité et accompagner la femme en respectant les recommandations professionnelles. Cependant, je ne peux garantir un accouchement sans complication, ni le fait qu’un transfert ne sera pas nécessaire.

Mon matériel (voir photo ci-dessus) comprend tout le nécessaire pour les constantes maternelles et fœtales, y compris le glucomètre, l’hémoglobinomètre et la saturation en oxygène, un Sonicaid étanche, deux monitorings sans fil dont un avec les capteurs étanches, un échographe portable, un ambu et des masques de différentes tailles, adulte et bébé, de quoi perfuser, de quoi bilanter, un défibrillateur. Une société d’oxygène livre à 37 SA une bouteille d’oxygène avec le nécessaire, masques et ambu. Ce n’est pas tout, j’ai aussi un aspirateur de mucosités, un pied à perfusion, un tabouret et un pouf d’accouchement, des écharpes mexicaines rebozo, une couverture chauffante, un tire-lait, des aiguilles d’acupuncture, de l’homéopathie, mais également de l’épifen, de l’ocytocine de synthèse, des solutés…
J’adhère à l’Association professionnelle de l’accouchement accompagné à domicile (APAAD). Depuis 2019, elle représente les sages-femmes accompagnant les accouchements à domicile et œuvre pour la reconnaissance de cette pratique, son intégration dans le système de santé et le soutien des sages-femmes AAD, notamment via l’antenne PACA. Nous échangeons régulièrement (en visio ou en présentiel) sur la collaboration ville-hôpital, les difficultés rencontrées, les pratiques obstétricales et les recommandations professionnelles. Un guide pratique de l’AAD, élaboré par l’APAAD et l’ANSFL, fixe des lignes directrices pour sécuriser la pratique, améliorer la coordination et servir de base à l’élaboration de recommandations cliniques afin de combler le vide juridique actuel (réf. p. 46). Tous les deux ans, je révise la gestion des urgences obstétricales extra-hospitalières en formation avec d’autres collègues libérales dans ma région ou ailleurs en France. Et je rends des comptes en saisissant mes dossiers dans la base de données d’Audipog. C’est une démarche volontaire à laquelle je souscris volontiers. Ces statistiques sont mises en place depuis 2019, avec pour finalité que notre accompagnement soit reconnu.
Il y a des gens à qui vous dites non ?
Absolument. La sélection des projets d’AAD se fait sur des grossesses simples à faible risque. C’est un critère important pour garantir la sécurité lors d’un accouchement physiologique, qui repose sur l’identification de facteurs de risque obstétricaux, médicaux ou sociaux. J’ai eu l’exemple d’une maman avec un diabète de grossesse qui voulait accoucher à domicile. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l’accompagner, trop risqué ! En dehors de ce critère essentiel de faible risque, il y a aussi le feeling et l’intuition que je peux ressentir face à un couple. Si je ne me sens pas ou plus en confiance, je stoppe le projet et les amène à se faire suivre à l’hôpital.
Chaque couple a également la possibilité de changer d’avis. Je dis toujours à mes patientes : « Tant que vous n’avez pas enfanté et délivré à la maison et que tout s’est bien passé, ça ne reste qu’un projet ».
L’AAD fait débat dans la profession. Vous sentez-vous parfois maltraitée par vos collègues, quand vous faites un transfert par exemple ?
Non, je n’ai pas subi de maltraitance verbale, en tout cas pas directement. Tout au plus du scepticisme et de la réserve. Quand un transfert a lieu sur un projet d’AAD, j’appelle l’équipe de la maternité pour leur expliquer la raison. Je consigne également par écrit tout ce que je fais pour que ça puisse être copié et remis dans le dossier obstétrical. J’accompagne le couple jusqu’en salle de naissance, je prends le temps d’échanger avec mes collègues, le gynéco-obstétricien de garde et/ou le pédiatre s’il est présent. Je délègue le couple aux bons soins de l’équipe, mais je garde contact avec lui, pour prendre des nouvelles. Les patientes que j’ai transférées ont toujours été accueillies avec bienveillance, le choix de ce projet est plutôt bien respecté et les équipes font en sorte de maintenir, dans la mesure du possible, au mieux et selon l’urgence, le caractère physiologique de la naissance et de ses suites.
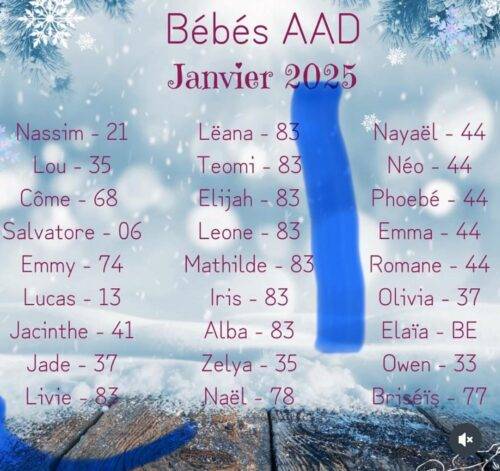
Quelles conditions devraient être réunies pour que l’AAD soit mieux intégré dans le système de santé ?
L’accouchement à domicile (AAD), bien que légal, reste marginal en France et peu reconnu par le système de santé. Pour le développer, il faudrait l’intégrer aux réseaux périnataux, établir des protocoles nationaux clairs, assurer un suivi épidémiologique et mettre en place une assurance professionnelle adaptée. Une meilleure coopération avec maternités et Samu est nécessaire, comme l’exemple des deux Savoie le montre. Enfin, la formation des sages-femmes devrait inclure davantage d’enseignement sur la physiologie de l’accouchement et l’accompagnement personnalisé. C’est le combat de l’APAAD qui est plutôt optimiste et met tout en œuvre pour travailler main dans la main avec le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF), la HAS, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), les sociétés savantes et les associations professionnelles et d’usagers pour reconnaître pleinement les compétences des sages-femmes et mieux organiser la collaboration ville-hôpital, si cruciale pour la sécurité des femmes et des professionnels. Les formations proposées par l’APAAD sur la physiologie et les urgences concernent toutes les sages femmes confondues.
Les déserts médicaux et les distances qui s’allongent jusqu’aux maternités ont-ils un impact ?
Oui ! Si une femme habite à plus de 45 minutes d’un hôpital, l’AAD n’est pas envisageable. Il y a aussi la question du choix de la maternité : si celle que la femme a en tête est trop éloignée, en cas d’urgence vitale, ce n’est pas envisageable et ce n’est pas négociable. Je lui demande toujours d’ouvrir un dossier dans la maternité la plus proche et si elle veut une autre maternité, rien ne l’empêche de faire une ouverture de dossier en double exemplaire. Anticiper un transfert, c’est être inscrite dans une maternité idéalement à moins de trente minutes de son domicile, avec un dossier complet. C’est avoir bénéficié d’une consultation avec un médecin anesthésiste au troisième trimestre de la grossesse dans la maternité d’inscription et avoir préparé, à huit mois de grossesse, une valise avec les choses nécessaires pour la femme et l’enfant pour un séjour hospitalier. Il y a aussi le problème de l’accessibilité des pompiers et du Samu au domicile. Il n’existe pas de texte de loi imposant un nombre de kilomètres, mais une durée de transfert raisonnable est une norme de sécurité : dans les recommandations, la HAS mentionne « le lieu d’accouchement doit permettre un transfert en moins de trente minutes vers une structure hospitalière adaptée ». Pour l’APAAD, les sages femmes évaluent la faisabilité logistique du domicile avant d’accepter l’accompagnement. L’Ordre national des sages femmes (ONSF) plaide pour des protocoles de transfert clairs et rapides, dans un délai compatible avec une prise en charge d’urgence.
Y a-t-il des exemples inspirants dans d’autres pays qui pourraient s’appliquer en France ?
Les Pays-Bas sont connus pour soutenir activement l’AAD : environ 13 % des femmes néerlandaises accouchent à domicile, souvent accompagnées d’une sage-femme formée spécifiquement. Le transfert à l’hôpital y est rapide, si besoin. Au Royaume-Uni, le système de santé public, ou NHS, propose l’AAD pour les grossesses à bas risque. Environ 2 % des accouchements se font à domicile et ce sont les sages-femmes communautaires qui assurent le suivi. Au Canada, c’est légal et encadré dans la plupart des provinces, avec un taux qui varie jusqu’à 3 % dans certaines zones. Les sages-femmes y sont bien formées et l’accès au transfert hospitalier est rapide si besoin. En Nouvelle-Zélande, l’AAD est bien encadré, grâce au système de santé très favorable aux sages-femmes. Dans ce pays, jusqu’à 3 % des naissances se font à domicile.

Vous ne passez pas tout votre temps à faire des AAD, vous avez aussi un cabinet ?
Oui, mon cabinet est au rez-de-chaussée de ma maison (photo ci-contre), avec son entrée dédiée. Je ne fais donc pas que des AAD, puisque je suis les couples et leur projet dès le début de la grossesse. Je les vois chaque mois et je fais une à deux visites à leur domicile, pour évaluer la faisabilité. Viennent ensuite les visites post-natales. Parfois mon accompagnement commence alors que la grossesse n’est encore qu’à l’état de projet. Je suis également des femmes qui souhaitent accoucher en structure hospitalière. Je fais de l’accompagnement global sauf les échographies trimestrielles et les IVG (sans être « contre ») : suivi de grossesse, post partum, suivi gynécologique de prévention, préparation à la naissance, vaccinations dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant, prescription d’actes, médicaments et vaccins en fonction de la liste autorisée au Journal officiel. La sage-femme est la spécialiste médicale de la physiologie. J’adresse mes patientes à un médecin lorsque je décèle une pathologie pour laquelle je peux pratiquer des soins prescrits par lui, en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. La collaboration reste essentielle entre tous les professionnels de la périnatalité. Comme mes consœurs et confrères, je tiens également un rôle de proximité primordial dans la prévention et l’information auprès des femmes, en contribuant au repérage des situations de violences faites aux femmes. Je repère également les dépressions post-natales, la première cause de décès maternels dans l’année qui suit une naissance étant le suicide et autres causes psychiatriques.
Je suis également acupunctrice et homéopathe, diplômée dans les deux disciplines. C’est dans la continuité de ma pratique, dans la lignée de la physiologie et des médecines alternatives. Ces outils m’aident à chaque étape de la grossesse, de l’accouchement et même en post-partum. J’ai d’ailleurs écrit un livre en 2008 : Guide pratique d’homéopathie en maternité, en auto-édition (réf. p. 46).
Que voyez-vous à domicile qui serait impossible à l’hôpital ?
Rien ! Je rigole… Je ne vois rien dans le sens où on est dans la pénombre et dans le silence, pour respecter au mieux le processus physiologique de la naissance. Imaginez des chats, des chiens, des cochons d’Inde, les ainés quelquefois qui souhaitent être présents dans une ambiance feutrée, silencieuse. Silencieuse, au fond pas tant que cela, car il arrive que la musique s’invite : les sons, les grognements, les vocalises… C’est la vie, quoi !
Certaines de vos consoeurs ont été inquiétées ces derniers mois, ces dernières années ?
Je préfère ne pas en parler. Je les soutiens, je m’y intéresse, ça pourrait être moi… Mais c’est leur histoire, elles seules peuvent la raconter.
La demande d’AAD va-t-elle augmenter, selon vous ?
Oui probablement. Aujourd’hui environ 35 % des femmes expriment le souhait d’accoucher à domicile. Les institutions et les maternités prennent conscience de cette demande croissante et adaptent leurs salles pour plus de physiologie.
Dans la région PACA, il y a quatre maternités à Marseille, Vitrolles, Digne les Bains et Toulon, qui disposent de salle(s) nature(s) dédiée(s) aux accouchements physiologiques. Vitrolles propose des accouchements dans l’eau.
La salle « alternative » à Hyères a fermé. Il y a aussi un plateau technique à la maternité d’Antibes, le « Nid’Antibes » et une maison de naissance à la maternité d’Aubagne « La Casa de naissance ». C’est encore trop peu…
Quels conseils donneriez vous à une sage-femme souhaitant se lancer dans l’accouchement accompagné à domicile ?
Mes trente années d’expérience professionnelle dans les maternités tous niveaux confondus en contact des professionnel(les) de santé et des femmes ainsi que mes formations et ma vie personnelle m’ont donné suffisamment confiance pour me lancer. Mais je suis d’accord avec l’APAAD qui recommande vivement aux sages-femmes débutant une activité AAD d’effectuer un compagnonnage, c’est-à-dire de travailler aux côtés de collègues plus expérimentées. Ce compagnonnage permet d’observer et d’accompagner plusieurs couples en continu, de faire face à la diversité des situations possibles et d’accroître progressivement sa pratique dans un cadre sécurisé avant de l’exercer de façon autonome. Au sein de cette formidable association qu’est l’APAAD, des formations sont spécialement conçues pour les sages-femmes AAD, regroupant compétences cliniques, simulations et apprentissages pratiques. C’est tellement riche d’enseignements, d’échanges et de contacts ! Et on ne se sent pas seule. Aux sages-femmes tentées par les AAD, je conseillerais vivement d’adhérer aux associations précédemment citées !
Interview réalisée par Stéphane Cadé



