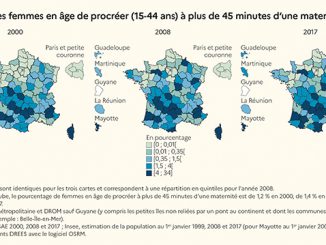La cartographie Urkind®, un support de communication pour le couple parental
Comment avez-vous découvert la cartographie Urkind® ? Élodie. La cartographie Urkind® nous a été proposée par la sage-femme qui m’a suivie pour ma première grossesse il y a quatre ans. Elle connaissait déjà l’histoire de notre couple et de notre famille, j’étais à l’aise avec elle et, tout naturellement, j’ai souhaité qu’elle me suive quand j’ai été enceinte à nouveau. Quand elle m’a présenté la cartographie, je me suis dit que c’était une bonne idée et cela me plaisait que nous puissions être tous les deux, avec Geoffrey, pour cet échange. La cartographie vous a-t-elle aidés dans le déroulement de la grossesse et la préparation de la naissance ? En quoi ? Élodie. La cartographie nous a permis de nous situer vis-à-vis de nos ressentis, de notre histoire de vie. Il faut être en confiance avec sa sage-femme pour pouvoir être sincère et honnête dans ses réponses. On se livre vraiment pendant cet entretien, et certaines questions touchent à notre intimité. Mais il ne faut pas avoir peur d’exprimer ses ressentis. Cela permet de se positionner sur différents sujets, de savoir où on en est, et d’entendre la parole de son conjoint. Parfois, on pense que l’autre « sait » ce que nous ressentons, comment nous vivons les choses, alors que ce n’est pas toujours évident. En cela, la cartographie a vraiment constitué un support de dialogue et de communication entre nous. Geoffrey. La cartographie nous a ouvert les yeux sur les images que chacun de nous avait de la grossesse, de la maternité, de la paternité. Nous avons pu identifier nos craintes quant à la parentalité. Dans la vie de tous les jours, nous nous parlons beaucoup, Élodie et moi, mais nous ne nous livrons pas autant. Je pense que la cartographie nous a permis d’aborder ensemble certains sujets dont nous n’aurions pas parlé […]