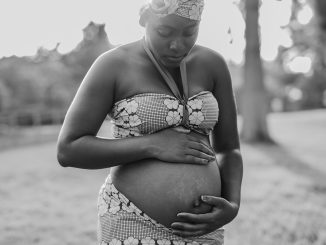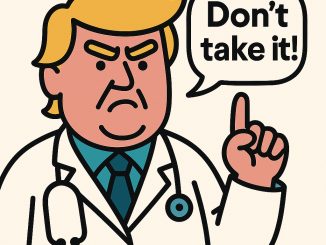Endométriose et maladies inflammatoires de l’intestin : un lien qui se précise
Des maladies qui partagent une même inflammation Les femmes atteintes d’endométriose présentent plus souvent des troubles digestifs, et certaines développent ultérieurement une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (Mici), comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Des expériences en laboratoire pour comprendre le mécanisme Afin de comprendre comment l’endométriose pourrait fragiliser l’intestin, une équipe chinoise a exposé des cellules intestinales à du liquide péritonéal prélevé chez des patientes atteintes d’endométriose sévère. Les observations sont frappantes : le liquide altère la cohésion entre les cellules intestinales, rendant la barrière plus perméable. Les tissus présentent également des signes d’inflammation et de stress cellulaire accrus. Autrement dit, les médiateurs inflammatoires produits dans l’endométriose pourraient contribuer à perturber l’équilibre intestinal et favoriser des processus inflammatoires chroniques. Une vigilance clinique renforcée Cette étude, qui devra être étayée par d’autres, esquisse un lien entre l’endométriose et les Mici. Elle plaide pour une vigilance accrue et une meilleure coordination interdisciplinaire afin d’améliorer leur qualité de vie....