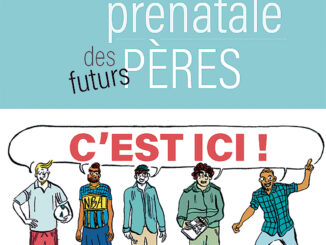
Partage 1 : expérience validée
Depuis 2016, à l’initiative de la Dre Pauline Penot (cheffe de service au CeGIDD de l’hôpital André Grégoire), plusieurs projets successifs se sont attachés à construire une consultation de prévention dédiée à tous les (futurs) pères, suite à la découverte de séroconversions au VIH chez des femmes enceintes multipares à la maternité de Montreuil. Cette maternité est de niveau 3 et réalise plus de 3 500 accouchements par an. Dans sa première phase pilote en 2018-2019, le projet visait à proposer dans un premier temps un dépistage du VIH aux futurs pères dans les salles d’attente de la maternité. Des besoins élargis en prévention primaire et secondaire des maladies infectieuses ont émergé du pilote : insuffisance de couverture vaccinale, absence de contact avec un professionnel de santé depuis l’arrivée en France pour de nombreux migrants, besoins de rencontre avec un psychologue ou un assistant social. Ces constats ont conduit à élaborer une offre systématique de consultation de prévention dédiée aux pères à la maternité : l’étude Partage. Partage 1 : faisabilité et acceptabilité d’une consultation prénatale masculine à la maternité André Grégoire de Montreuil L’objectif était d’évaluer l’acceptabilité et les conditions de transfert en pratique clinique courante d’une consultation prénatale de prévention à destination des futurs pères. Lors de cette consultation, un bilan biologique adapté à l’interrogatoire incluant une sérologie VIH était proposé au conjoint. À cela s’ajoutaient si besoin une mise à jour du calendrier vaccinal, une ouverture des droits sociaux, le référencement à un autre professionnel selon les besoins et un adressage actif vers un médecin traitant si nécessaire. En adoptant une démarche très proactive de recueil des coordonnées des pères et d’appel systématique de ces derniers, 1 347 pères ont eu accès à la consultation entre le 25 janvier 2021 et le 28 avril 2022 (taux d’acceptation de 45 %). Cette recherche a démontré la faisabilité...









