Une confrontation brutale avec la mort L’analyse de huit études qualitatives a permis de faire émerger une métaphore globale résumant l’expérience vécue : « Être touchée par la mort tout en donnant naissance à la vie ». Trois grands thèmes ont été identifiés, à commencer par « Quand la mort rôde », qui relate le basculement soudain d’un moment de vie vers une lutte pour la survie. L’HPP est décrite comme une expérience sensorielle et psychique extrême : une peur aiguë de mourir, une douleur insoutenable et un sentiment de déconnexion du corps. Une femme témoigne : « J’avais perdu tellement de sang si rapidement que j’étais, en fait, en train de mourir et je pouvais me sentir mourir et m’éloigner en quelque sorte. » Certaines ont comparé la douleur à celle d’un acharnement physique : « Je me souviens que beaucoup de personnes se sont relayées pour me frapper l’estomac… J’essayais de les repousser. » Les gestes médicaux d’urgence – compression utérine, manœuvres manuelles – bien que nécessaires, sont vécus comme traumatiques et marquent durablement la mémoire corporelle. À cette souffrance s’ajoute la peur de laisser derrière soi un nouveau-né et un partenaire : « À la suite de ce que j’ai ressenti comme un frôlement de la mort, je suis plus anxieuse à l’idée de perdre mon partenaire ou mon bébé… » © istockphoto-1307751887 Une cicatrice émotionnelle durable Le second thème, « Vivre avec une cicatrice émotionnelle », décrit les répercussions post-traumatiques de l’HPP : fatigue persistante, difficultés à s’occuper du bébé, cauchemars, évitement d’une nouvelle grossesse. L’épreuve laisse un sentiment d’échec, de culpabilité et de solitude : « Je dois admettre que l’idée d’accoucher à nouveau me fait peur. J’ai presque l’impression d’avoir trompé la mort une fois et je ne veux pas tenter le sort. » Certaines femmes évoquent une forme de dissociation pendant l’hémorragie, avec un sentiment de vide ou d’absence. Pour d’autres, l’allaitement devient un…
Sur le même thème

Pas d’écran avant 6 ans : le cri d’alerte pour protéger le cerveau des enfants
Des dégâts bien visibles dans le quotidien Langage en retard, troubles de l’attention, sommeil perturbé, agitation motrice… « les professionnels de la petite enfance constatent les dégâts quotidiennement ». Longtemps, le message était : pas d’écran avant 3 ans. Mais les auteurs de la tribune appellent à étendre cette vigilance jusqu’à 6 ans. Leur message est limpide : « En 2025, le doute n’est plus permis ». Ce n’est ni la technologie de l’écran ni le contenu diffusé — même dit éducatif — qui est en cause, mais bien le principe même de l’exposition à un âge aussi vulnérable. « L’enfant n’est pas un adulte en miniature : ses besoins sont différents. » Le cerveau en développement : une mécanique fine, vite perturbée Le neurodéveloppement repose sur une alchimie subtile entre génétique et interactions multisensorielles avec le monde réel. L’enfant apprend en mobilisant tout son corps, tous ses sens, en lien avec des personnes, des objets, des sons concrets. Or, les écrans, au contraire, imposent un flot d’images rapides, de stimuli sonores et lumineux trop intenses, qui saturent l’attention sans nourrir la compréhension. « Ce flux compromet les connexions neuronales non encore consolidées, pouvant altérer durablement le fonctionnement de son cerveau. » En d’autres termes, l’enfant est sursollicité, mais mal stimulé. L’écran ne propose que des interactions appauvries, en deux dimensions, sans logique sensorielle ni communicative. Moins d’écrans, plus de liens Autre effet collatéral : la diminution des échanges au sein de la famille. Or, c’est dans ces moments partagés que se construisent les compétences langagières, sociales et émotionnelles. En réduisant ces interactions, les écrans « coupent le lien d’apprentissage du langage et des compétences socio-relationnelles ». Des risques physiques tout aussi préoccupants Les conséquences ne sont pas seulement cognitives. Les auteurs alertent aussi sur les effets physiques. L’exposition prolongée aux écrans peut provoquer une myopisation précoce, altérer la rétine en raison de la lumière bleue et...
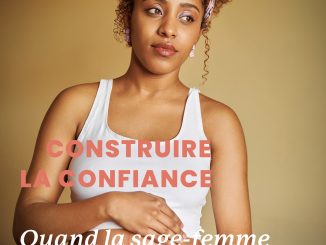
Construire la confiance, pas à pas : quand la sage-femme devient point d’ancrage
Dans les parcours cabossés par la précarité, les violences ou l’exil, les sages-femmes sont souvent les premières à briser l’isolement. « On entre dans leur intimité, on voit dans quel état est leur logement, on mesure leurs difficultés », raconte Julie Chateauneuf, sage-femme à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui accompagne également des femmes migrantes ou en situation de précarité. Elle insiste sur l’importance du lien humain : « Avant de pouvoir parler de contraception ou d’allaitement, il faut déjà qu’elles aient mangé, qu’elles se sentent en sécurité ». Pour ces femmes qui vivent dans l’errance administrative, la peur du rejet ou le traumatisme d’un parcours migratoire, la sage-femme est parfois la seule figure professionnelle qui ne les juge pas. Certaines patientes n’ont jamais eu de suivi médical ou n’osent plus consulter. Julie Chateauneuf précise : « Il faut expliquer qu’on n’est pas là pour dénoncer, qu’on est tenues au secret professionnel. » Un engagement de terrain au plus près des femmes Dans ces contextes de grande précarité, certaines sages-femmes exercent au sein de structures associatives comme l’ADSF (Agir pour la santé des femmes), qui intervient auprès de femmes sans logement ni couverture sociale. Les consultations ont lieu dans des camions aménagés, des foyers ou même l’espace public. L’objectif dépasse le soin : repérer les souffrances silencieuses et offrir une présence humaine continue. Pour Morgane Revel, sage-femme coordinatrice du staff médicopsychosocial à la maternité Paris Saint-Joseph, la première consultation est décisive. « C’est souvent là qu’elles posent leur histoire. On leur demande si elles ont vécu des violences, si elles ont un logement. Elles se livrent plus qu’on ne le croit. » Ces instants de partage permettent parfois de poser les jalons d’un nouveau départ. Une -parole confiée devient un fil d’Ariane. « Lors d’un premier rendez-vous, une patiente a éclaté en sanglots quand je lui ai simplement demandé comment elle allait. C’était la...

Violences faites aux sages-femmes
En 2005, l’Observatoire des violences en santé (ONVS) a été créé, au sein de la Direction générale de l’offre de soins. Il recueille, sur la base du volontariat, les signalements de faits de violence (atteintes aux personnes et aux biens, incivilités) commis dans les établissements, sur la voie publique et depuis 2020 dans le cadre de l’exercice libéral. Chaque année, l’ONVS publie un rapport sur ces violences et, depuis plusieurs années, près de 20000 signalements de violences à l’encontre des personnels soignants sont enregistrés par an. La violence en milieu de santé revêt de multiples formes, physiques et verbales ; elle s’exerce à l’hôpital, en cabinet médical, dans les centres de santé, en Ehpad, envers les soignants comme envers le personnel. En ce sens, le rapport publié par l’ONVS en novembre 2022 fait état de chiffres particulièrement alarmants. Alors qu’il recensait 17 598 atteintes aux personnes en 2021, il en dénombrait 17 756 en 2020, des chiffres très probablement sous-estimés. En 2021, la part des violences physiques dans ces atteintes aux personnes représentait 50,9 %, tandis que celle des violences verbales s’élevait à 32,1 %. Selon une enquête réalisée par l’Ordre national des infirmiers en 2023, plus de 66 % des infirmiers ont subi des violences et 75 % ont été victimes d’insultes dans l’exercice de leurs fonctions. Les rapports constatent également que les professionnels de santé n’effectuent souvent pas les démarches pour dénoncer ces violences, estimant qu’elles sont inutiles, n’aboutissent à rien et ne sont pas soutenues. Face à la hausse de ces violences, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé avait été présenté en 2023 par le Gouvernement. Une proposition de loi, dont l’examen avait été interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, vient d’être reprise et enrichie par les parlementaires et par le Gouvernement. Cette proposition de loi a pour but de mieux lutter contre...
