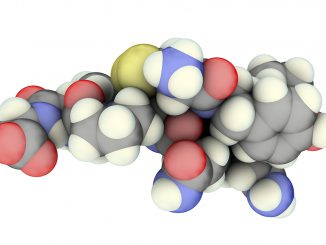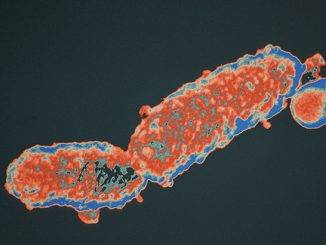Véronique Suquet : « La sexualité des jeunes a beaucoup changé »
Quels sont les principaux résultats de votre enquête sur l’évolution de la sexualité des jeunes en France ? L’âge moyen du premier baiser, à 13,6 ans, et celui du premier rapport sexuel, à 17 ans, sont assez stables. Mais ce sont quasiment les seules constantes. Tout le reste a beaucoup changé. Par exemple, il y a aujourd’hui une disparité beaucoup plus grande sur l’âge du premier rapport sexuel. L’étalement est plus grand. Certains jeunes sont plus précoces, annonçant un premier rapport à 13 ans, quand d’autres ont des rapports beaucoup plus tard. L’accroissement du nombre de partenaires est plus affolant. J’ai travaillé avec un échantillon de 200 jeunes âgés de 17 à 30 ans qui ont répondu à un questionnaire en ligne courant 2021. La moyenne d’âge est de 23 ans. Or les jeunes hommes annoncent une moyenne de 10 partenaires, avec une médiane à 5,5, et les jeunes femmes une moyenne de 7 partenaires, avec une médiane à 4. C’est beaucoup plus élevé que les chiffres annoncés dans de précédentes études, même si c’est difficile de comparer. Il y a tout de même une explosion de ce chiffre. Certaines personnes ne savent même pas donner le nombre approximatif de partenaires, tellement il est élevé. Ils peuvent annoncer 99, quand d’autres parlent de 70 ou 80. Il y a également une forte croissance de la sexualité orale puisque 77 % des jeunes annoncent avoir pratiqué des fellations et 74 % des cunnilingus. Par ailleurs, 100 % de la population masculine de l’échantillon ont visionné de la pornographie, en commençant en moyenne à 13 ans. Deux tiers en consomment régulièrement. Certains y ont accès dès 8 ans. Du côté des filles, 66 % d’entre elles en ont visionné, commençant en moyenne à 16 ans. En parallèle, seul un tiers des garçons trouvent l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle insuffisante, contre deux tiers des filles. Comment […]