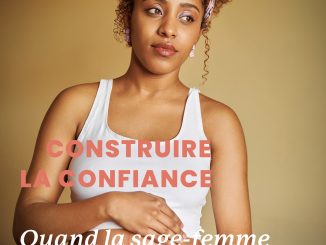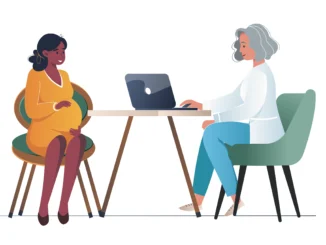
Exercer seule, sans être isolée : comment les sages-femmes libérales tiennent le cap
La liberté d’organisation reste la première motivation des sages-femmes qui choisissent le libéral. Pouvoir gérer son temps, ses patientes et son rythme d’exercice séduit par la souplesse qui en découle. Mais cette autonomie, vécue comme un soulagement au départ, peut rapidement devenir source d’isolement. « L’isolement, la surcharge de travail et le manque de relais sont des problématiques récurrentes », souligne Éliette Bruneau, présidente de l’Association nationale des sages-femmes libérales (ANSFL). Sans équipe à ses côtés, la praticienne doit assumer seule les urgences, la gestion administrative et la comptabilité. « Certaines finissent par ne plus prendre de vacances », constate-t-elle. “ L’isolement, la surcharge de travail et le manque de relais sont des problématiques récurrentes “ Eliette Bruneau Pour Daphnée Breton, psychologue du travail et référente du réseau Souffrance et Travail Paris ¹, ce mode d’exercice rend particulièrement vulnérable : « L’absence de collectif prive les praticiennes d’un soutien à la fois sur le plan technique (compétences, débats sur l’analyse des pratiques et de l’organisation du travail) et sur le plan émotionnel (écoute, entraide, reconnaissance) ». Le manque de relais aggrave le sentiment de fatigue et d’impuissance. Les premiers signaux sont discrets : irritabilité, troubles du sommeil, perte d’envie. Puis viennent la lassitude et la dévalorisation de soi. À cela s’ajoute une autre forme de pression : la crainte de perdre sa patientèle ou de ne pas assurer la continuité des soins en cas d’arrêt. Beaucoup repoussent le moment de souffler, au détriment de leur santé. Pascale Primault, sage-femme à Pont-l’Abbé, a longtemps observé ce cercle vicieux : « Quand on travaille seule, il n’y a personne pour dire stop. Le risque, c’est de ne plus savoir poser de limites ». Quand le collectif devient force Installée depuis 2020 à Pont-l’Abbé, Pascale Primault a fait le choix d’un -c-abinet de groupe avec deux consœurs qu’elle connaissait déjà à l’hôpital. « C’était un choix réfléchi...