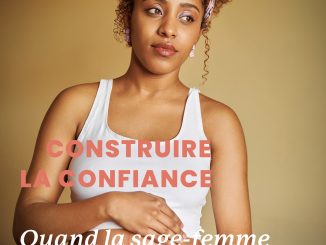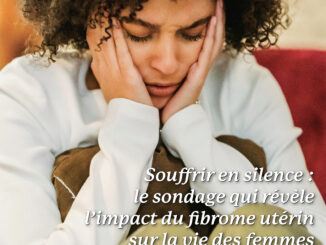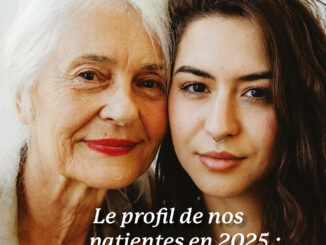Étudiant·e·s sages-femmes et déjà engagé·e·s
« Le métier a un côté féministe : on soutient la santé et le droit des femmes. Naturellement, la filière attire des profils qui sont, à la base, engagés. Il n’y a pas de sage-femme qui ne le soit pas d’une certaine façon ou d’une autre », raconte Chloë Grunenwald, présidente de l’Association nationale des étudiant·e·s sages-femmes (ANESF). À 22 ans, elle a pris une année de césure pour honorer son mandat. Ses causes, c’est la reconnaissance des sages-femmes et la lutte contre la précarité des étudiant.e.s. Dernier chantier : la réforme de la formation « qui va bientôt sortir ! Cela aura pris deux ans ! », s’exclame-t-elle. Et de conclure :« Aucune d’entre nous ne s’engage pour elle-même. On a des études suffisamment prenantes. Pour nous, c’est coûteux, c’est du sommeil en moins. On le fait pour la profession. » Elle est animée par une véritable vocation à défendre les étudiant.e.s sages-femmes (ESF). Une vocation parmi tant d’autres. L’engagement associatif, bénévole et militant des ESF est pluriel. Il dépasse largement les revendications corporatistes. C’est un engagement civique et solidaire, caractérisé par la convergence des luttes et l’intersectionnalité, les enjeux environnementaux et climatiques, le souci de la santé publique, de l’autre, tout simplement. “ Aucune d’entre nous ne s’engage pour elle-même. […] On le fait pour la profession ” Aider les personnes à la rue C’est ce à quoi se consacre Sterenn Lesaux, en troisième année de maïeutique. On la retrouve une soirée par semaine, devant les finances publiques de Rennes, ou à Saint-Melaine, les deux points fixes de la Croix-Rouge de la capitale bretonne. Elle y distribue des boissons chaudes, des couvertures : « Comme l’hiver approche, on a fait une récolte à Décathlon pour récupérer des gants, des bonnets, des duvets. Beaucoup de -chaussettes aussi. » On entre dans la période critique que Sterenn redoute. L’année dernière, il y a eu plusieurs décès. ...