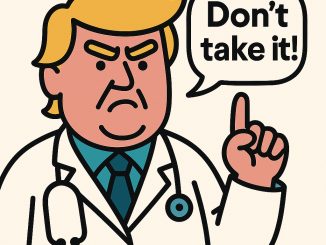Non, l’Ozempic ne fait pas grandir le pénis !
Les plus modestes revendiquent « 2,5 cm de gain », les plus enthousiastes carrément « près de 4 cm en sept mois ». Côté experts, la douche est plus froide : l’Ozempic n’allonge pas le pénis. Niet. Nada. Il s’agit d’une illusion d’optique. Usage détourné En ralentissant la vidange de l’estomac, l’Ozempic diminue l’appétit, favorisant la perte de poids. D’où son usage détourné chez des personnes non diabétiques, dans un but d’amincissement. C’est là que se trouve la clé du troublant mystère de l’allongement du pénis… Le sexologue Wilfrid Pavageau dévoile le pot aux roses sur Doctissimo : « La raison principale de cet agrandissement est la diminution de la masse graisseuse. » Chez certains hommes obèses, la graisse pubienne peut recouvrir la base du pénis. Lorsqu’ils perdent du poids, cette graisse fond, et la partie enfouie du sexe ressort, donnant l’impression que le pénis est plus grand. En réalité, seule sa visibilité augmente. En revanche, l’amincissement permet effectivement un meilleur flux sanguin vers le pénis, ce qui signifie des érections plus fermes et rigides....