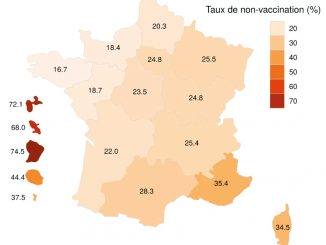Anamnèse
Manon*, 41 ans, consulte sur recommandation de notre consœur et associée. Cette dernière vient de la prendre en charge en suivi gynécologique. Nous nous connaissons déjà Manon et moi. Nous l’avons accompagnée il y a quinze ans, à l’occasion de la naissance de son second enfant. Les deux accouchements de Manon se sont déroulés sans problème : par voie basse avec périnée intact. Les nouveau-nés pesaient 2950 et 3150 g.
Manon est en bonne santé avec un indice de masse corporelle normal. Elle est agent immobilier à son compte. Elle a « toujours » fait des infections urinaires. Mais elle témoigne que cela va en s’aggravant depuis quelques années. Son gynécologue étant parti à la retraite, Manon en a parlé à son médecin généraliste il y a environ quatre ans. Elle avait alors été adressée à un urologue. Un traitement, dont elle ne se souvient plus du nom, lui avait été proposé pendant un an, mais celui-ci n’a pas amélioré la situation.
Depuis six mois, Manon souffre de deux infections urinaires par mois environ. Ses infections sont caractérisées par leur place dans le cycle menstruel, avant ou après les règles, et toujours après un rapport sexuel. Un « tue-l’amour » pour Manon.
Lors du bilan périnéal, l’interrogatoire retrouve :
• une IUE à l’effort (toux, éternuement et course à pied),
• une vessie parfois impérieuse quand elle doit se retenir (Manon peut enchaîner les visites de biens immobiliers sans repasser par son domicile),
• des pesanteurs imprévisibles, sans lien avec une infection,
• des gênes lors des rapports sexuels, à titre de brûlures, mais aussi d’autres douleurs, inconstantes, qu’elle n’arrive pas à caractériser.
L’examen clinique met en évidence :
• un testing périnéal à 5 parfaitement équilibré, avec un bon relâchement,
• une muqueuse saine,
• une hystéroptose stade 1,
• une cystocèle stade 1.
Manon s’était mise à l’athlétisme il y a 4 ans et pratiquait la course à pied 3 fois par semaine. Depuis 2 ans, elle se contente de courir 1 fois par semaine.
Le calendrier mictionnel, réalisé sur 2 jours différents – avec et sans déplacements à l’extérieur – est caractérisé par une hydratation anarchique, de 1 à 2 l selon les jours, et des mictions de précaution alternant avec des heures de retenue.
Le contrôle d’ECBU s’avère négatif.
Soins proposés
Nous commençons par lui proposer de boire au quotidien entre 1,5 à 1,8 l d’eau, voire plus en cas d’activité sportive. Ces apports sont à répartir régulièrement au cours de la journée, en commençant pendant 1 mois par 1 sachet de Femannose®N au réveil dans un verre d’eau. Nous lui prescrivons aussi 1 sachet après chaque rapport, à renouveler dans les 4 à 6 heures suivantes, à hauteur de 3 sachets le premier jour puis 2 sachets le lendemain.
Femannose®N
Femannose®N est un dispositif médical indiqué dans le traitement et la prévention des cystites et autres infections urinaires simples basses. Le D-mannose peut réduire les symptômes les plus fréquents des infections des voies urinaires basses (brûlures lors de la miction, mictions fréquentes, impériosité mictionnelle, etc.), quand elles sont déclenchées par des bactéries du type Escherichia coli.
Le D-mannose est un épimère du glucose qui inhibe de manière significative l’adhésion d’agents pathogènes à l’épithélium urinaire, permettant ainsi d’éviter l’ancrage de ces microbes quand ils migrent dans l’appareil urogénital. Constituant essentiel de la paroi vésicale, le D-mannose libre, présent dans Femannose®N, en se substituant au D-mannose physiologique, va favoriser la capture des E. coli dans la vessie, selon le mode d’action suivant : Femannose®N bloque les fimbriae des E. coli en suspension dans l’urine, empêchant leur fixation sur l’urothélium vésical. Femannose®N décroche les bactéries déjà fixées sur la paroi vésicale. Les bactéries en suspension sont éliminées par le flux urinaire.
Le D-mannose n’étant pas métabolisé, il n’interfère pas avec d’autres substances. L’utilisation concomitante de Femannose®N et d’antibiotiques n’affecte pas l’efficacité des antibiotiques. Femannose®N ne favorise pas l’apparition de résistances microbiennes [1].
Compte tenu des récentes prises d’antibiotiques de Manon, des probiotiques par voie vaginale et digestive sont conseillés. Nous recommandons également l’utilisation généreuse de lubrifiant lors des pénétrations.
Enfin, nous lui rappelons la nécessité de toujours vider la vessie sur un vrai besoin (exit les pipis de précaution), d’éviter de se retenir de manière prolongée, de s’asseoir sur les toilettes et de « laisser pisser ».
La posture idéale aux toilettes
La position spontanément adoptée par les enfants dans la nature pour aller à la selle est la position accroupie, pieds parallèles, talons au sol, celle des toilettes à la turque. Cette position, en antéversion du bassin, permet un alignement thoraco-abdominal respectueux de la place des organes, de la mobilité du diaphragme, d’une respiration abdominale basse. Le périnée est détendu, ouvert à l’avant comme à l’arrière. C’est donc aussi la position idéale pour la miction chez la fillette comme chez sa mère. Si la vessie est pleine, la vidange se fait naturellement, sans effort, sans poussée. Le hic c’est que la plupart d’entre nous, devenues adultes, ne sommes plus capables de prendre et de tenir cette position. Pour beaucoup de femmes, l’alternative consiste alors à ne pas s’asseoir sur les toilettes (d’autant que dans l’imaginaire collectif, s’asseoir sur les toilettes serait une source d’infection…) et de se positionner en « squat ». Cette position va totalement à l’inverse de la physiologie, en rétroversion du bassin, diaphragme descendu, respiration bloquée, exerçant ainsi une poussée sur la vessie et une contraction réflexe du périnée. La vidange devient artificielle, apparentée à un effort de poussée. De plus, elle est bien souvent partielle [2].
Le suivi
Pendant les vacances d’été, une nouvelle infection urinaire survient. Manon prend conscience qu’elle n’avait pas bu suffisamment ce jour-là. Un calendrier mictionnel de contrôle est demandé pour s’assurer de la bonne compréhension des consignes.
À la rentrée, en complément des premières mesures, nous lui prescrivons un pessaire cube pour les activités physiques à fort impact, comme la course et la danse [3]. Le dispositif est très vite adopté. Manon prend le réflexe de le porter chaque fois qu’elle pense en avoir besoin (activité sportive, soirée dansante, etc.)[2].
Très vite, la situation s’améliore. La dernière infection urinaire a lieu lors des vacances de Noël, quand l’attention se relâche à nouveau en matière d’hydratation quotidienne.
Lors de l’entretien d’évaluation, sept mois après le début de la prise en charge, la satisfaction est évaluée par Manon à 10 sur 10 [4]. Une consultation de suivi est prévue à six mois.
Discussion
L’infection urinaire postcoïtale touche principalement :
– la femme jeune,
– la femme ménopausée [6].
L’infection urinaire débute dans les 4 à 24 heures suivant le rapport. Chez les femmes jeunes n’ayant pas eu d’enfant, des brides hyménéales sont souvent retrouvées. Certains proposent parfois de les prendre en charge chirurgicalement. Elles disparaissent systématiquement lors d’un accouchement par voie basse. Dans les deux cas, laissent-elles un tissu cicatriciel favorable aux infections urinaires postcoïtales ? Nous n’avons pas trouvé de littérature à ce sujet.
Chez les femmes ménopausées, la carence en œstrogènes à l’origine d’une atrophie vaginale est souvent associée aux autres facteurs de risques d’infection urinaire. La prescription d’œstrogènes par voie locale est recommandée [3]. À défaut – refus de la patiente ou contre-indication – l’utilisation de produits à base d’acide hyaluronique peut être envisagée.
Dans tous les cas, les conseils hygiénodiététiques sont toujours bienvenus (toilette, prise en charge de la constipation chronique ou ponctuelle). Plutôt que de demander aux femmes de vider leur vessie après le rapport, nous préférons leur conseiller de prendre un sachet de D-mannose dans un grand verre d’eau, ce qui va favoriser le besoin et la vidange naturelle. Il ne faut pas omettre de faire préciser les pratiques sexuelles afin de donner des conseils préventifs le cas échéant (utilisation de préservatifs si pénétration anale, utilisation de sextoys qui peuvent être blessants, etc.).
En cas de périnée hypertonique, un travail de rééducation visant la détente du périnée doit être envisagé. En cas d’échec, le recours aux antibiotiques à titre « préventif » peut être prescrit par un médecin [5, 6].
Le cas de Manon, non ménopausée, est atypique. Il est probablement favorisé par un début de prolapsus. Mais il soulève surtout l’intérêt d’interroger à minima les femmes sur leur sexualité et leurs pratiques – un champ de compétences qui reste à développer chez les sages-femmes – et à savoir adresser à un autre professionnel (sexologue, urologue, gynécologue) selon les problèmes identifiés.
* Le prénom a été modifié
Sophie Frignet, sage-femme libérale et formatrice à l’Institut de Gasquet, est l’autrice du livre Le Périnée des filles aux éditions de l’Éveil (2018).
Elle déclare des liens d’intérêt avec l’Institut de Gasquet.
Références bibliographiques
[1] Vidal, 2021.
[2] De Gasquet B. Périnée, arrêtons le massacre. Marabout, 2011
[3] Le pessaire cube peut dorénavant être prescrit par les sages-femmes. Même si, paradoxalement, il n’est pas remboursé par l’Assurance Maladie https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092
Les œstrogènes peuvent être prescrits dans l’indication « Topiques à activité trophique et protectrice »
[4] Démarche éducative de type Bercer. Rinehart W, Rudy S, Drennan M. Gather guide to counseling. Popul Rep J 1998;(48):1-31.
[5] HAS. Cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, de la femme. Mise à jour juillet 2021
[6] https://www.revuegenesis.fr/les-cystites-post-coitales/