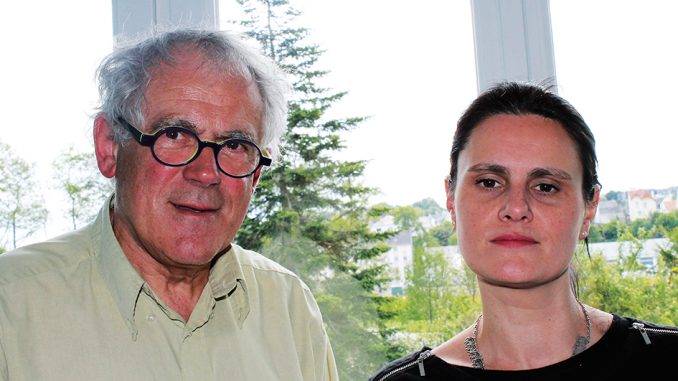
Dans ce rapport, vous revenez sur la genèse des professions d’obstétricien, gynécologue et sage-femme. Quel était votre objectif ?
Alain Vilbrod : L’un des enjeux était de savoir dans quelle mesure les différents professionnels impliqués peuvent coopérer. Dans le chapitre historique, notre prisme est nouveau. Nous retraçons l’histoire des interactions entre les différents professionnels, en soulignant ce qu’il a pu en être des rapports de domination qu’ont vécus les sages-femmes, alors qu’historiquement ce sont elles qui occupaient la première place auprès des femmes. La situation actuelle est redevable de cet héritage dont les uns et les autres peinent à se libérer. Il n’y a qu’à voir la victoire sémantique des médecins, avec l’expression « accouchement à bas risque » qui s’est imposée pour évoquer les accouchements physiologiques ou eutociques. C’est donc davantage qu’un rappel historique, mais une focale sur les interactions entre les différents acteurs à travers le temps.
Sans surprise, vous décrivez des relations en tensions. De quelle nature sont-elles ?
Florence Douguet : Il s’agissait de montrer les freins et les difficultés de collaboration entre ces professionnels, mais aussi d’analyser les éventuels leviers qui existent pour surmonter ces tensions. Nous avons par exemple montré que dans les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), le fait de cohabiter dans une même structure ne rend pas les collaborations plus faciles. Médecins et sages-femmes n’ont pas les mêmes préoccupations de départ lorsqu’ils montent de tels projets. Ils interviennent dans des champs différents. De nombreuses sages-femmes en MSP ont l’espoir que les généralistes leur adressent des femmes, ce qui n’est pas nécessairement le cas sur le terrain. Globalement, nous avons montré que « les médecins parlent aux médecins » et que les généralistes se tournent davantage vers les gynécologues. La proximité ne fait pas nécessairement plus de lien. Les médecins ont conservé leurs habitudes de collaborations avec leurs collègues ou les services hospitaliers.
Alain Vilbrod : Par ailleurs, nous avons souligné combien la mise en œuvre des compétences des sages-femmes reste mal connue. Peu d’études cliniques s’y intéressent de près. La seule étude sérieuse concerne les maisons de naissance et elle a fait grincer des dents et suscité des débats à l’Assemblée nationale lorsqu’il a été question de les pérenniser. Les mots ont été choisis dans le décret pour que les maisons de naissance soient encore très intégrées aux maternités hospitalières.
Par ailleurs, nous manquons de travaux comparatifs entre les actes réalisés par les sages-femmes, les gynécologues médicaux, les obstétriciens et les généralistes pour valider ou infirmer certains discours alarmistes concernant les compétences des sages-femmes. Est-ce qu’elles commettent davantage de bévues lors des poses de stérilet ou lorsqu’elles accompagnent des femmes en période de ménopause ? Rien ne permet de l’affirmer alors que de nombreux discours médicaux l’affirment.
Il faut cependant nuancer et il n’y a pas d’unanimité des discours. Du côté des obstétriciens, le discours très critique du Syngof vis-à-vis de l’extension du champ de compétences des sages-femmes n’est sans doute pas représentatif. Du côté des gynécologues médicaux, qui sont en majorité des femmes aujourd’hui, une proportion importante est rétive à la montée en compétences des sages-femmes, car elles sont en concurrence directe. Mais on observe un glissement du champ d’action des gynécologues médicaux, qui s’occupent davantage des questions de fertilité. Leurs compétences se déplacent, car le noyau dur de leur métier est « grignoté » par les sages-femmes.
Concernant la posture patriarcale qui subsiste, de façon variable et non homogène, de la part des gynécologues-obstétriciens et que les sages-femmes dénoncent, nous avons revu certains a priori. D’une part, la défiance devant la coopération entre professionnels ne dépend pas de l’âge ou de la génération des gynécologues-obstétriciens. De nos enquêtes, il ressort même que les anciens seraient plus favorables à des collaborations plus égalitaires avec les sages-femmes. De même, on aurait pu penser que les gynécologues-obstétriciennes femmes, de plus en plus nombreuses, seraient plus égalitaires. Or devenir médecin passe par de longues années d’études, certaines formes de socialisation que les femmes endossent. Ni le genre ni le niveau de maternité où ils exercent ne modifient la perception des obstétriciens.
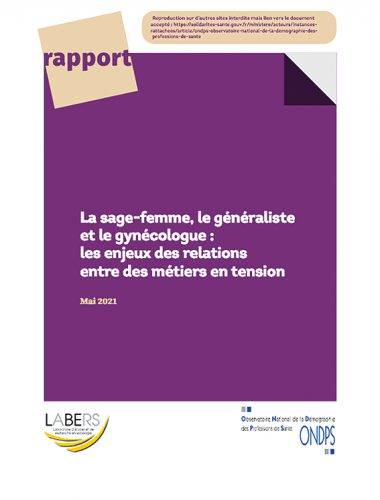
Des tensions existent également entre sages-femmes en établissement et libérales. Pourquoi ne pas s’y être attardé ?
Alain Vilbrod : Ce n’était pas l’enjeu du rapport. Toutefois, il y a bien sûr des interactions complexes entre sages-femmes hospitalières et libérales, mais ce n’est pas unanime. Nos enquêtes nous permettent de relativiser cette opposition entre sages-femmes. D’abord, parce qu’un tiers des sages-femmes libérales exerce encore en maternité, de façon mixte. Et il est encore très récent que des sages-femmes s’orientent vers le libéral dès l’obtention de leur diplôme. L’installation en sortie d’école ne relève pas toujours d’une défiance envers la médicalisation de la grossesse ou de l’accouchement. Les raisons de s’orienter vers le libéral sont plurielles et en partie liées aux conditions d’emploi, à l’absence de perspective avec des CDD à répétition. Pour les jeunes sages-femmes, quitter l’hôpital est parfois un arrachement.
Florence Douguet : Le lien entre hospitalières et libérales perdure avec le Prado ou les systèmes de coordination permettant d’assurer les suivis du post-partum à domicile. En MSP, c’est bien l’esprit d’équipe qu’elles ont connu à l’hôpital que les libérales recherchent. Nous avons repéré des situations où les sages-femmes se retirent des MSP lorsqu’elles n’y ont pas retrouvé l’esprit collectif espéré.
En revanche, nous pointons dans le rapport des inquiétudes sur la concurrence entre sages-femmes libérales. Là où régnaient une bonne entente et une grande collaboration, des tensions émergent quand les installations sont nombreuses sur un territoire et qu’une concurrence se fait jour.
Est-ce qu’une gradation des soins, contraignant les patientes à s’adresser d’abord aux professionnels de premier recours pour leur suivi, avant d’être adressées éventuellement à des spécialistes, serait de nature à diminuer les tensions entre professionnels ?
Florence Douguet : Nous n’avons pas étudié cette question. Est-ce que cela favoriserait les échanges entre professionnels concernant les patientes communes ? Par ailleurs, les médecins généralistes sont aussi des professionnels de premier recours. Or, on ne peut que constater qu’ils connaissent mal le contenu de la formation et les compétences des sages-femmes. Plusieurs études ont montré que les jeunes médecins les méconnaissent tout autant. Favoriser des formations communes, voire la réalisation de mémoires en commun, serait intéressant pour étendre les connaissances entre les uns et les autres. Pour l’instant, ce sont souvent les expériences informelles et personnelles qui permettent de se connaître entre professionnels.
Alain Vilbrod : Tant que l’on considère la grossesse et l’accouchement comme étant à risque, et alors que la frontière entre eutocie et dystocie est labile au cours de l’histoire et dans les faits, le chamboulement sera long entre obstétriciens et sages-femmes. Or pour l’instant, les premiers sont souvent très dépourvus devant un accouchement qui se déroule bien. C’est la dystocie qui les fait vibrer et pour laquelle ils ont été formés. À l’hôpital, les sages-femmes sont cependant bien en première ligne. Notre enquête souligne l’étendue des ressources qu’elles ont développées pour composer en situation de domination, en faisant alliance avec les patientes et en sachant comment s’y prendre avec les médecins. Décider quand appeler l’obstétricien ou l’anesthésiste est au cœur de leur travail, par exemple. Et l’on voit bien qu’elles pourraient aller encore au-delà des compétences qui leur sont attribuées. Certains gynécologues-obstétriciens sont d’ailleurs prêts à leur en laisser davantage. Au sein des maisons de naissance, on voit bien qu’elles sont à même de passer la main dès lors que la situation fait appel à des compétences qu’elles n’ont pas.
Ce rapport est publié dans le contexte d’un mouvement social des sages-femmes et semble faire contrepoids au rapport de l’Igas…
Alain Vilbrod : Sans doute ne faut-il pas prendre le rapport de l’Igas au pied de la lettre, en ne retenant qu’une formule maladroite. Il a sans doute été rédigé rapidement. Notre rapport a été publié à dessein après celui de la mission de l’Igas par l’ONDPS et les rapporteurs ont bénéficié de nos travaux.
Pour notre part, nous ne sommes pas partisans d’un corps professionnel plutôt que d’un autre. Nous ne portons pas de jugement, mais nous nommons les choses. Le rapport de domination des médecins envers les sages-femmes est un constat objectif. Nous rappelons les faits, comme les différences de revenus entre les professionnels. Aujourd’hui, les sages-femmes interrogent légitimement leur niveau de rémunération ou le fonctionnement même des services hospitaliers. Ce rapport souligne les tensions entre professionnels, mais aussi les alliances possibles entre eux.
Alors que l’historien Jacques Gélis s’interrogeait sur la possible disparition de la profession de sage-femme, dans son livre La Sage-femme ou le Médecin publié en 1988, la démographie de la profession est au contraire en augmentation aujourd’hui, contrairement à celle des gynécologues médicaux.
Nous sommes par ailleurs en train de mener une étude avec des collègues suisses et belges sur les sages-femmes au temps du Covid. Nous avons recueilli des récits épiques montrant la réactivité et l’inventivité des sages-femmes pour trouver des masques, s’organiser alors que les PMI ou les cabinets de gynécologues avaient fermé. La profession est réactive et totalement en prise avec ce qu’expriment les femmes.
■ Propos recueillis par Nour Richard-Guerroudj


