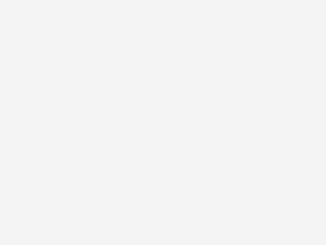Adoptée à l’unanimité lors de sa première lecture à l’Assemblée nationale, le 25 novembre dernier, la proposition de loi visant à faire évoluer la formation des sages-femmes est bien partie. Bientôt, les sages-femmes seront des docteures en maïeutique, grade universitaire qu’elles obtiendront au terme de six années d’études et de la soutenance d’une thèse d’exercice. La mesure figure aussi au menu du récent accord conclu entre le Gouvernement et plusieurs centrales syndicales (lire p. 9). Ce troisième cycle des études de sages-femmes pourrait arriver très vite, les premières docteures en maïeutique pouvant être diplômées dès 2025, si l’on se fie à la proposition de loi encore en discussion. Le texte a en effet été renvoyé au Sénat, qui, à l’heure à laquelle nous écrivons, n’a pas encore fait connaître son calendrier sur le sujet. Les sénateurs étant souvent plus frileux, le doute reste de mise. Cependant, à l’Assemblée nationale, le texte n’a rencontré aucune opposition ni abstention. Les 64 députés présents lors de la discussion ont voté pour. Et avant même son examen, la proposition de loi avait été cosignée par 136 députés, issus de tous bords politiques.
UN SUJET CONSENSUEL
Cette sixième année d’études fait également consensus au sein de la profession, tout au moins de ses représentants. Les organisations professionnelles de sages-femmes, associations et syndicats, y compris les centrales, y sont favorables. L’accord s’est également exprimé au cours des auditions devant la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, demandées par la députée Annie Chapelier.
« On n’a entendu qu’une seule et même voix, tout le monde allant dans le même sens, disant que cette sixième année d’études était une nécessité, rapporte-t-elle. Il en est d’ailleurs allé de même pour les autres sujets de la proposition de loi, comme l’achèvement de l’intégration universitaire et la permission aux sages-femmes chercheuses de maintenir une activité clinique. Nous nous attendions à quelques réserves de la part de certaines personnes, comme les représentants de la Conférence des doyens ou les présidents d’université, mais ils ont été eux aussi unanimes. Un doyen gynécologue a même souligné que ses confrères n’y sont absolument pas opposés. Selon ses termes, c’est plus une question de génération que de profession. Chez les jeunes médecins, il y a une demande forte pour que les sages-femmes puissent développer leur art et leur profession en tant que tels. Les auditions nous ont étonnés par leur convergence. Cela renforce la conviction que notre proposition va dans le bon sens, répond à des besoins, est nécessaire. »
ÉLÈVES EN SOUFFRANCE
Ce résultat est une victoire à porter au compte de l’Association nationale des étudiants sages-femmes (Anesf), qui fait un travail colossal depuis plusieurs années. L’histoire commence en 2018. L’association mène alors une « enquête bien-être », qui révèle que les élèves sages-femmes vont mal (lire Profession Sage-Femme n° 251, Décembre-Janvier 2018). D’ailleurs, en préambule de sa proposition de loi, la députée
Annie Chapelier souligne que « 7 étudiantes sur 10 présenteraient des symptômes dépressifs. » « Ce malaise est surtout dû à l’intensité des cours et à la pression due à la formation, explique Laura Faucher, actuelle présidente de l’Anesf. Nous avons donc décidé de comparer la formation des sages-femmes à d’autres formations médicales. En moyenne, en cinq ans de formation, nos études comptent entre 1200 et 1400 heures de plus que celles d’odontologie, une formation pourtant étalée sur six ans. Cela montre un réel souci sur les volumes horaires. La comparaison avec la formation des pharmaciens revient à peu près au même. » Autre comparaison possible : sur les seuls deux premiers cycles d’études, qui durent aussi longtemps en maïeutique qu’en odontologie, la formation de sage-femme compte de 20 % à 30 % d’enseignement supplémentaire, qu’il s’agisse de théorie ou de clinique. Ces éléments sont présentés dans un argumentaire documenté, une « contribution » sur laquelle l’Anesf a planché pendant deux ans. Validé en juin 2021, le document a été porté auprès des divers acteurs de la profession et des deux ministères concernés, avec qui l’Anesf a multiplié les rendez-vous depuis l’été, sur fond de revendications sociales plus larges de la profession.
« La charge de travail des étudiants a effectivement augmenté, confirme Isabelle Derrendinger, directrice de l’école de sages-femmes de Nantes et secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes. Ce n’est pas étonnant, car le programme a été pensé en 2011-2013 sur un référentiel de compétences qui est un peu daté aujourd’hui. Depuis 2009, on a ajouté la gynécologie, le service sanitaire, l’éducation à la vie affective et sexuelle, la réalisation des IVG médicamenteuses et bientôt instrumentales, l’amélioration de l’échographie obstétricale et fœtale. Il faut aussi penser à la santé environnementale et aux mille premiers jours, à l’accompagnement des personnes en situation de handicap… Tout cela n’est pas officiellement dans le programme, mais nous recevons des injonctions de la part des universités, des ARS, des Régions… En tant qu’enseignantes, nous ne décidons pas du programme, qui est fixé par arrêtés. Mais il faut tout de même rajouter ces enseignements. Paradoxalement, les autres formations issues de la Paces (médecine, odontologie et pharmacie) ont déjà vu leurs premier et deuxième cycles révisés deux fois alors que leur champ de compétences n’a pas évolué, à part, pour les pharmaciens, sur la vaccination contre la grippe et le Covid ainsi que la réalisation de certains tests de détection du coronavirus. »
Sur le terrain, les étudiants qui reportent la soutenance de leur mémoire après l’obtention de leur diplôme sont de plus en plus nombreux. Cette possibilité leur est accordée pendant deux ans depuis un arrêté de 2013. « Ce report de mémoire est un symptôme, concède la directrice d’école. Pour ces étudiants qui ont commencé à travailler, la réalisation de leur mémoire est plus difficile. En plus de leurs gardes, ils sont loin de leur école, avec un accompagnement pédagogique moins soutenu. Sans parler des difficultés engendrées par ce report pour les encadrants. » Ainsi, le constat est sans appel : il faut réformer les études de sage-femme. D’autant plus que dans les hôpitaux, les anciennes sages-femmes ne trouvent pas toujours les nouvelles diplômées très opérationnelles.

La PPL Chapelier, un texte rétréci ?
Dans la première version de son texte, la députée Annie Chapelier proposait 26 articles qui balayaient largement les enjeux de la profession. Lutte contre les déserts médicaux, accès aux soins, protocoles de coopération entre médecins et sages-femmes, statut de praticien hospitalier, liste de prescriptions… Certaines mesures étaient d’ailleurs loin de faire l’unanimité chez les sages-femmes (lire Profession Sage-Femme n° 273, juillet-août 2021). La proposition de loi présentée le 25 novembre dernier devant l’Assemblée nationale ne retient que quatre articles (intégration universitaire, statut de maître de stage universitaire en maïeutique, création d’un troisième cycle, activité clinique pour les enseignants-chercheurs). Pour Annie Chapelier, il s’agit d’une manœuvre technique et stratégique. « Je porte cette proposition de loi dans le cadre d’une niche parlementaire, explique-t-elle. C’est le seul moment où les parlementaires peuvent porter leurs propositions de loi et non pas les textes écrits par le Gouvernement. Lors de ces niches, nous devons passer entre 6 et 7 textes du groupe parlementaire. Cela impose une étude des textes qui doit être rapide. L’étude de la première version du texte aurait demandé au moins une journée entière et aurait empêché mes collègues d’aborder les autres propositions de loi. En réalité, seul le Gouvernement a la possibilité de porter un texte aussi dense. Il y a aussi une raison plus politique à l’évolution du texte. Certains sujets, comme celui du statut des sages-femmes, sont encore très clivants, en particulier au niveau du Gouvernement et de certains professionnels. Ils nécessitent beaucoup de débats. Je me suis donc concentrée sur la formation. Les articles retenus sont consensuels, très concentrés sur un sujet, et permettent de poser une première pierre solide à l’édifice de la réforme. »
CONSOLIDER LES ENSEIGNEMENTS
Cette sixième année devrait donc permettre d’étaler les enseignements, de manière à rendre le quotidien plus supportable. Pour Charlotte Baudet, secrétaire générale adjointe de l’Organisation nationale des syndicats de sages-femmes (ONSSF), « cette sixième année ne vise pas à rajouter beaucoup de contenu. Il s’agit surtout de mieux répartir le contenu qu’il y a déjà ». Laura Faucher, la présidente de l’Anesf, nuance le propos : « Cette sixième année permettra aussi d’approfondir les compétences qu’on a rajoutées aux sages-femmes sans que la formation n’ait été réévaluée. » Gynécologie, orthogénie, procréation médicalement assistée, néonatalogie, pédiatrie, échographie… Les enseignements théoriques et pratiques à renforcer chez les sages-femmes restent nombreux. Ils méritent davantage que le saupoudrage actuel et devraient figurer officiellement au programme. À l’avenir, les sages-femmes en exercice pourraient éviter certains diplômes universitaires qu’elles ne suivent que pour consolider des compétences de base vues trop partiellement pendant leur formation initiale. « On peut aussi imaginer la possibilité d’une césure entre le deuxième et le troisième cycle pour faire un peu de recherche, ajoute Laura
Faucher. Aujourd’hui, on ne peut suivre le M2 recherche qu’une fois diplômée. Or, une fois diplômée, il faut aussi travailler pour vivre et c’est difficile de se relancer sur une année de master. Ce temps permettrait également d’approfondir certains sujets comme les violences faites aux femmes ou l’accompagnement des personnes LGBT, de se pencher sur la pédagogie étant donné qu’on doit aussi encadrer des étudiants dès qu’on est diplômée, parfois même au cours de notre première garde… Tout cela permettrait d’avoir les bagages qui nous manquent encore aujourd’hui pour être de meilleures professionnelles. »
Mais la réforme des études ne pourra se résumer à l’ajout d’une année supplémentaire. C’est l’ensemble du programme qu’il faudra revoir, premier et deuxième cycles inclus. La refonte du socle commun est d’autant plus importante que les dernières réformes des études médicales ont multiplié les portes d’entrée dans le cursus de maïeutique.
En conséquence, les étudiants n’ont pas tous le même niveau. Pour les détails concernant le contenu de la maquette de formation, tous les acteurs attendent la mission de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) promise par le Gouvernement.
Les ministères de la Santé et de
l’Enseignement ont annoncé à l’Anesf que cette mission aurait lieu dès la fin du premier trimestre 2022, suivie d’une publication des décrets qui régissent la formation au deuxième trimestre 2022, pour une application à la rentrée 2022. Un calendrier qui paraît utopique et « oublie » le possible remaniement gouvernemental de mai prochain.

ANNÉE BLANCHE ?
Cette révision du contenu des études doit s’accompagner d’un renforcement et d’une diversification des stages. De façon à consolider l’ensemble des compétences, ces stages doivent pouvoir se faire en ville comme à l’hôpital. Problème : comment rémunérer les sages-femmes libérales qui accueillent des stagiaires ? La proposition de loi Chapelier veut y répondre, avec la création d’un statut de maître de stage universitaire. Pour Isabelle Derrendinger, il doit être calqué sur le statut de maître de stage en médecine générale, qui est bien décrit au niveau de son rôle, sa formation, son activité clinique, son régime indemnitaire et les modalités de l’agrément avec l’université. Ce statut devrait pouvoir entériner la diversification des lieux de stage et l’allongement de ces expériences pratiques. « Ces dernières années, avec les cours supplémentaires, la durée passée en stage a diminué », témoigne Laura Faucher. Maître de conférences en maïeutique à l’université de Paris, Anne Chantry confirme : « Des compétences classiques en obstétrique et en néonatalogie ne sont aujourd’hui plus maîtrisées parce que lors de la dernière réforme, on a perdu 22 semaines de stage. L’année dernière, pour son mémoire de fin d’études, une étudiante s’est questionnée sur l’aisance des nouvelles diplômées à suturer une épisiotomie. Le résultat nous a beaucoup interrogées. Nombreuses sont les jeunes à être terrifiées par l’accouchement d’un bébé un peu gros, car elles ne savent pas recoudre. Des compétences qui devraient être acquises sur le bout des doigts ne le sont plus. Ces compétences ont été vues, pour certaines étudiantes consolidées, mais pas définitivement acquises. Dans certaines écoles, les étudiantes ne font par exemple qu’une semaine de stage en orthogénie. On ne peut pas imaginer qu’une jeune diplômée soit autonome sur ce type d’activité avec pareil bagage. Autre souci : la formation n’est plus tout à fait en adéquation avec les objectifs de santé publique. La deuxième cause de mortalité maternelle en France est le suicide. Comment les jeunes diplômées peuvent-elles dépister, identifier les femmes concernées, les accompagner, connaître le système à mettre en place autour d’elles si elles ne sont jamais allées en unité mère-bébé, si elles n’ont pas fait de stage en service de psychiatrie périnatale ? »
Pour Vincent Porteous, de l’Ufmict-CGT, les stages de la sixième année devront être « internés » et rémunérés. « Cette sixième année doit être professionnalisante, espère-t-il. Cette rémunération évitera aux familles le coût d’une année d’études supplémentaire. Surtout, ces stages internés permettront d’éviter une année blanche. » Cette « année blanche », pendant laquelle aucune nouvelle sage-femme n’arriverait sur le marché de l’emploi, ne paraît pas si redoutée. Les étudiantes et étudiants de sixième année seront probablement au moins aussi opérationnels que les nouvelles diplômées du moment. Et ils pourront se perfectionner au cours de ces « stages internés », parfois jusqu’à combler quelques postes vacants. C’est ce qu’imagine Charlotte Baudet : « La sixième année pourrait être une sorte d’internat court, avec une part prépondérante de stages pratiques. Cela permettra aussi d’absorber en partie le déficit de sages-femmes généré par cette année blanche. Par ailleurs, cette année blanche sera très circonscrite dans le temps. Et nous avons déjà eu cette expérience à au moins deux reprises dans l’histoire récente de la formation des sages-femmes, avec l’allongement des études de trois à quatre ans, puis de quatre à cinq ans. » Selon l’actuelle proposition de loi Chapelier, cette année blanche pourrait survenir en 2024-2025.
THÈSE D’EXERCICE
C’est au cours de cette même année que les premières docteures en maïeutique devraient soutenir leur thèse d’exercice. Bien différente d’une thèse de troisième cycle en sciences, habituellement réalisée en trois ans, la thèse d’exercice est un mémoire de fin d’études à peine amélioré. « Ce changement de nom peut se faire dès demain, clame l’enseignante Anne Chantry. Le niveau actuel des mémoires de fin d’études est globalement aussi bon que celui de nombreuses thèses d’exercice de médecins. » Pour Charlotte Baudet, de l’ONSSF, « il est de notoriété publique que les mémoires de sages-femmes sont de grande qualité. Il ne va pas falloir une montée en gamme énorme de ces travaux de recherche de fin d’études pour prétendre à la thèse d’exercice. Ce sera seulement décalé d’un an. » Isabelle Derrendinger, qui dirige l’école de sages-femmes de Nantes, ne dit pas autre chose. Comme elle encadre aussi des thèses d’exercice en médecine générale, la comparaison est facile. Cette thèse d’exercice donnera aux sages-femmes le grade de docteur en maïeutique. « Ce titre permettra d’ancrer dans l’esprit de tout le monde que le métier de sage-femme est une profession médicale », veut croire la députée Annie Chapelier.
Ainsi, la sixième année vise à l’obtention d’un diplôme d’État de sage-femme conférant le grade universitaire de docteur en maïeutique. Il en va de même pour les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, qui ont un diplôme d’état en plus de leur grade de docteur. Comme le précédent master, obtenu avec la cinquième année, ce doctorat, obtenu au cours de la sixième année, s’inscrirait dans le cadre de la réforme LMD (licence, master, doctorat). Sauf que l’intégration universitaire des écoles de sages-femmes, qui aurait dû être achevée en 2017, est en panne. « On est toujours au milieu du gué, dénonce Isabelle Derrendinger.
La plupart des écoles sont encore en train de contractualiser avec une université, une ARS, un hôpital et une région qui ont tous des avis différents. Le dispositif actuel n’est pas homogène. Certaines écoles sont même en rétropédalage sur leur universitarisation. » Avec sa proposition de loi, Annie Chapelier espère forcer tous les acteurs à se mettre autour d’une table pour faire aboutir le projet. Dans sa version actuelle, son texte impose une date buttoir à 2027. Pourtant, « lors d’une réunion, le Gouvernement nous a clairement dit qu’il ne travaillerait pas sur ce sujet, raconte Laura Faucher, la présidente de l’Anesf. Ce n’est pas une priorité de sa fin de mandat. Par ailleurs, quelques intégrations d’écoles à l’université, pour les rares qui ont abouti, ne se passent pas bien, spécialement pour les enseignantes sages-femmes, qui sont moins bien payées que si elles travaillaient à l’hôpital. Sur les 34 écoles distribuées sur l’ensemble du territoire national, 11 ont intégré l’université, dont 6 seulement l’ont fait pleinement, avec des budgets qui ne dépendent plus que de l’État. » Dans ce cadre, le statut des sages-femmes enseignantes, spécialement celles qui n’ont pas de doctorat, questionne. « Ce statut des enseignantes est déjà une problématique actuelle, rappelle Laura Faucher. Elles n’ont par exemple pas pu toucher la prime CTI, autrement appelée prime Ségur, ce qui contribue à leur précarisation. Malheureusement, nous avons encore peu de visibilité sur ce sujet. »
QUEL SALAIRE POUR LES DOCTEURES ?
Avec des futures docteures en maïeutique, se dirige-t-on vers un système de sages-femmes à deux vitesses ? « Il y a déjà eu des précédents, rassure Charlotte Baudet, de l’ONSSF. Le métier a évolué, les compétences ont évolué. Les anciennes sages-femmes se sont formées tout au long de leur vie professionnelle. Nous sommes toutes sages-femmes et cette réforme n’y changera rien. La querelle de générations redoutée lors du précèdent passage des études de 4 à 5 ans s’est rapidement amenuisée. » Il faut dire que les salaires n’ont pas suivi, y compris pour celles qui étaient davantage formées. Blasées par des décennies de luttes stériles, certaines sages-femmes regardent d’ailleurs ce nouveau projet de réforme des études d’un œil fatigué. Avec une angoisse : qui acceptera de subir six années d’études difficiles, pour devenir docteure en maïeutique, afin de gagner entre 1800 et 2000 euros de salaire net mensuel ? Si le sujet de la rémunération n’est jamais abordé dans le cadre de la refonte de la formation des sages-femmes, il apparaît en filigrane. Pour l’ensemble des acteurs, la révision des salaires constitue l’étape suivante. « Les dentistes commencent à 4700 euros. Ils sont docteurs et ont fait six ans d’études. Nous, les sages-femmes, nous serons aussi docteures et aurons aussi fait six ans d’études, évoque Charlotte Baudet. Il n’y a aucune raison pour qu’il y ait une telle différence. À l’ONSSF, nous tablons sur un salaire de début de carrière à 3000 euros net et autour de 6000 euros en fin de carrière, contre un salaire à 1800 euros en début de carrière et près de 3000 euros en fin de carrière aujourd’hui. Il est primordial de redonner de l’attrait à ce métier. Sinon, c’est la mort assurée de la profession. Or, le remplacement des sages-femmes par d’autres professionnels entraînera une catastrophe au niveau de la morbimortalité maternelle et néonatale, ce qu’on observe déjà ailleurs. »
Les chercheuses vont remettre leur blouse
Les rares maîtres de conférences en maïeutique que compte la France vont-elles pouvoir retourner à la clinique ? Si la proposition de loi de la députée Annie Chapelier est votée en l’état, ce sera possible. À ce jour, la bi-appartenance hospitalo-universitaire, accordée aux médecins, pharmaciens et dentistes qui sont également enseignants-chercheurs, est encore refusée aux sages-femmes. « Cette bi-appartenance est une évidence absolue, soutient Anne Chantry, maître de conférences en maïeutique à l’université de Paris, enseignante à l’école de sages-femmes de Baudelocque et chercheuse épidémiologiste à l’Inserm. On ne conçoit plus aujourd’hui qu’un enseignant continue à enseigner des activités qu’il ne pratique plus. Il doit pouvoir rester sur le terrain pour éviter le hors-sol. Par ailleurs, la clinique inspire énormément nos travaux de recherche. En sciences médicales, notre objectif est d’améliorer la santé des mères et des enfants de demain. Il s’agit de recherche appliquée. Comment changer le système de soins ? Comment améliorer les pratiques cliniques ? Le terrain vient nourrir les hypothèses de recherche. Sans terrain, on en a toujours parce qu’on lit, on va dans les congrès, on échange avec des gens, mais ce n’est pas pareil. Être sur le terrain permet aussi de construire des projets de recherche réalistes, qui tiennent compte des difficultés pratiques de mise en place. Autre élément très important : priver les sages-femmes chercheuses de leur activité hospitalière les empêche de répondre à des appels à projet pour financer leurs travaux de recherche. Aujourd’hui, une très grosse partie des appels à projet en sciences médicales vient des hôpitaux. Or, pour y candidater, il faut être hospitalier. En tant qu’enseignant-chercheur mono-appartenant, exclusivement universitaire, on n’a pas le droit. Pour contourner le système, il faut trouver des prête-noms praticiens hospitaliers. Ce sont le plus souvent des médecins. Mais si l’on veut faire vivre la recherche en maïeutique, il faut que les sages-femmes puissent répondre à ces appels à projet. » La France a très tardivement reconnu la maïeutique comme une discipline de recherche pleine et entière. Elle accuse un énorme retard en la matière et le chemin pour devenir sage-femme chercheuse reste un parcours du combattant. Pour comparaison, la Suède compte 176 sages-femmes chercheuses pour 16 millions d’habitants, contre seulement 3 en France pour une population quatre fois supérieure. En réalité, les sages-femmes qui font ou ont fait de la recherche dans notre pays sont plus nombreuses : une petite cinquantaine. Mais comme elles ont dû emprunter des chemins de traverse pour y parvenir, elles ne travaillent pas directement en maïeutique. En Angleterre comme dans d’autres pays, les sages-femmes chercheuses ont un statut social élevé. En France, une maître de conférences en maïeutique a un salaire inférieur à celui d’une sage-femme hospitalière qui débute. À peine née, la recherche en maïeutique française reste encore fragile.
■ Géraldine Magnan