Texte élaboré par le Cercle Qualité « Pro-Phy » de l’Arcade Sages-femmes Genève : Céline Bergoz Détraz, Ivana Cerovaz, Ana Bela Gallo, Viviane Luisier, Véronique Spinnler, Eugenia Weimer.
La rédaction remercie la Fédération suisse des sages-femmes et les auteurs pour leur aimable autorisation de reproduction.
L’Arcade Sage-femmes à Genève a constitué un Cercle Qualité « Pro-Phy » qui a œuvré durant trois ans pour notamment faire évoluer la préparation à la naissance (PAN) et l’évaluer pour savoir si elle favorise réellement un accouchement physiologique. Les membres du Cercle Qualité livrent dans cet article les résultats de leurs recherches.
À partir d’un article de l’anthropologue Irène Maffi (2014), des questions surgissent à l’adresse des sages-femmes. L’article débusque une position ambigüe de la part de celles-ci, qui prônent l’accouchement physiologique tout en préparant les parents à accepter les diktats des institutions de naissance (hôpitaux et cliniques). Le texte appelle à une clarification, à une détermination des sages-femmes et aussi des parents. Que veulent les sages-femmes et que mettent-elles en œuvre pour obtenir ce qu’elles estiment être le meilleur pour les parents et les nouveau-nés ? Les parents sont-ils vraiment informés de tous les choix qu’ils pourraient faire sans se mettre en danger ni eux ni leur bébé ?
Intéressées par ces questions, un groupe de six sages-femmes se forme alors, sages-femmes qui vont travailler :
- comme Cercle Qualité (CQ) : elles vont tenter de cerner par diverses approches le problème posé par l’article susmentionné afin de faire évoluer leur pratique de sages-femmes et de préparatrices à la naissance ;
- comme groupe de recherche : elles vont réfléchir à une intervention concernant la préparation à la naissance (PAN) et vont tenter d’évaluer cette intervention pour en tirer des recommandations.
Ce groupe de sages-femmes se forme en janvier 2016 et travaillera jusqu’en juin 2019. Il s’agira d’un groupe où les participantes s’engagent à effectuer du début à la fin les tâches que le groupe s’assigne. La partie recherche de cette initiative sera rétribuée par l’Arcade qui dispose d’une ligne budgétaire ad hoc.
Trois objectifs, seulement deux résultats
Des trois objectifs élaborés en 2016, seuls deux d’entre eux seront atteints.
Le premier, faire connaître largement les textes récents concernant l’accouchement physiologique et fondés sur des preuves au public des professionnel·le·s de la naissance et des parents, a été l’objet du fascicule Chers parents, vous avez le choix ! (Cercle « Pro-Phy », 2017). Au sommaire :
- Entre parents et sages-femmes ;
- Repères pour réfléchir à votre accouchement ;
- Références utiles avant et après la naissance ;
- Définition de la sage-femme ;
- La LAMal et les prestations sages-femmes ;
- Statistiques pour Genève ;
- Coûts approximatifs de l’accouchement à Genève, etc.
Le deuxième objectif, qui aurait voulu favoriser les contacts entre professionnel·le·s de la naissance (sages-femmes, médecins) et parents, n’a pas été atteint, faute de groupes de parents organisés à Genève.
Le troisième objectif, rénover la PAN tant dans ses objectifs que dans son déroulement et l’évaluer, afin de savoir si la PAN contribue véritablement au déroulement physiologique de l’accouchement, a été l’objet de la recherche dont les résultats sont présentés ci-dessous.
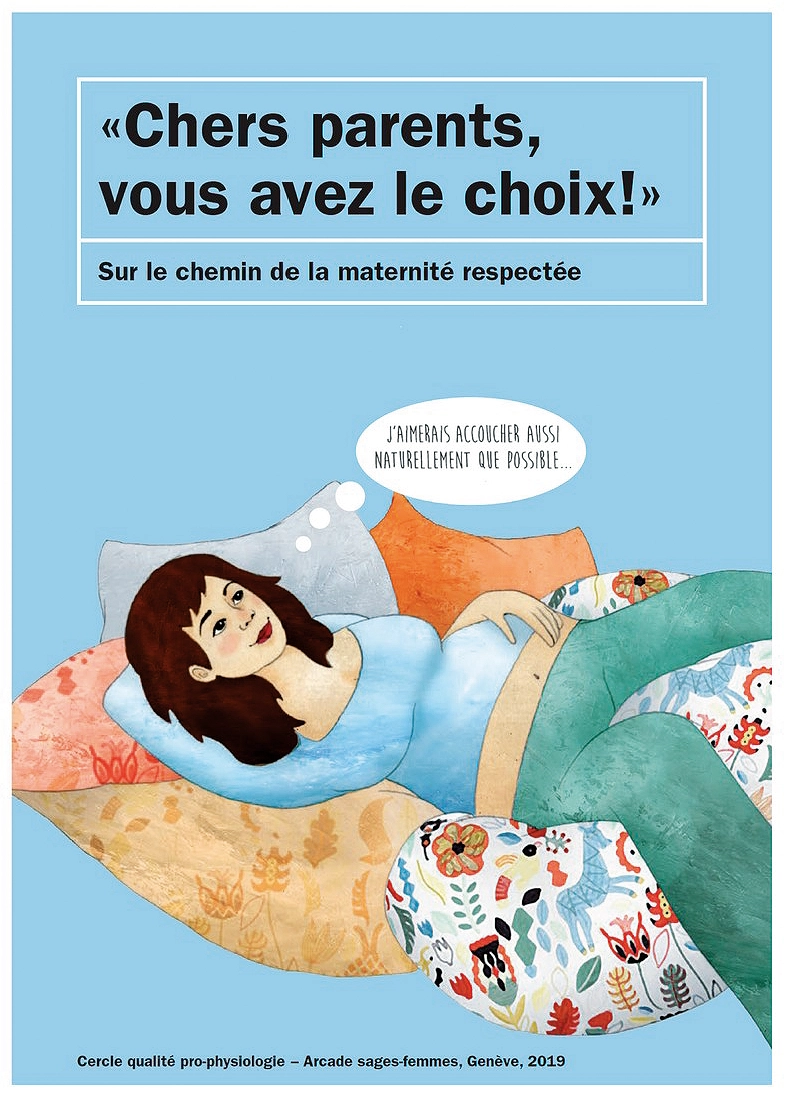
à l’Arcade Sages-femmes : info@arcadesf.ch ou
en visitant le site www.arcade-sages-femmes.ch.
Une recherche-action : Organisation de la PAN
La question de départ était ainsi formulée : une préparation à la naissance axée sur la physiologie de l’accouchement pourrait-elle permettre une diminution des provocations, instrumentations, césariennes et péridurales ?
Des flyers étaient à disposition à l’Arcade Sages-femmes dès 2017, annonçant la couleur de notre PAN. Une vitrine présentait aussi l’activité aux passant·e·s.
Nous avons élaboré ensemble, à cinq sages-femmes (l’une d’entre nous n’a pas participé à cette activité), les contenus et les moyens de nos rencontres de PAN. Voici la proposition qui a été faite aux parents :
- Quatre sessions de 8 heures chacune ont été organisées chaque année pendant 2 ans. Chaque session comportait donc 4 rencontres : 2 à l’Arcade Sages-femmes, 1 à domicile (individuelle, effectuée avec la sage-femme qui suivrait le post-partum), 1 à la maison de naissance La Roseraie afin de pouvoir expérimenter les installations d’une salle « nature » comme elle existe à la maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les séances collectives étaient prises en charge par deux sages-femmes, permettant ainsi l’intervision.
- Les rencontres insistaient sur la création d’une « bulle » imaginaire dans laquelle s’installerait la parturiente dès le début du travail, sur les ressources non médicales pour traverser la douleur, sur l’importance de l’élaboration d’un plan de naissance, sur les positions à adopter pendant le travail et l’accouchement proprement dit, etc.
- Les moyens utilisés étaient le mannequin « Rikepa » (bassin, utérus, placenta, poche des eaux, fœtus), une vidéo de trois minutes relatant le voyage du fœtus dans la filière pelvienne, un théâtre miniature illustrant ce que pouvait ressentir la femme pendant les contractions, les démonstrations-expérimentations, les jeux de rôle, etc. Un portfolio était mis à disposition des participant·e·s, avec notamment le texte de Leboyer sur les contractions, tiré de son livre L’Art du souffle (Leboyer, 2006).
- Les cours étaient financés en partie par la contribution de la LAMal et en partie par le budget recherche de l’Arcade, de telle sorte que les parents n’avaient rien à payer. La visite à domicile pré-partum était comptée comme une visite prénatale. Comme cette PAN axée uniquement sur l’accouchement était à considérer comme un projet-pilote, nous tenions à ce que notre prestation soit totalement gratuite pour les parents qui y participaient.

Participation
Trente-cinq femmes, accompagnées la plupart du temps de leur conjoint, ne présentant pas de complications de la grossesse et comprenant le français, primigestes, se sont inscrites à nos rencontres, dont deux ont été retirées (une pour accouchement prématuré, l’autre pour abandon). Huit femmes sur 33 ont écrit leurs impressions dans une lettre qu’elles nous ont retournée. Quinze sur 33 ont participé aux rencontres postnatales où l’on interviewait chaque participant·e (lorsque la femme venait avec son conjoint) avec quatre questions :
- Comment s’est déroulé votre accouchement ?
- En quoi la PAN vous a-t-elle été utile ?
- En quoi la PAN a-t-elle été inutile ?
- Qu’est-ce qui a manqué à la PAN que vous avez reçue ?
Essai de comparaison
Nous avons rassemblé des données de la maternité des HUG, des accouchements « Bien Naître » (le seul groupe de parents que nous avons pu rencontrer, parents qui ont bénéficié de l’accompagnement d’une sage-femme agréée) et de deux sages-femmes de l’Arcade d’accord pour relever les données de notre questionnaire. Les réponses étant lacunaires, nous avons gardé seulement la péridurale et la césarienne comme éléments de comparaison.
Étant donné les très nombreux biais et les grandes différences entre tous ces groupes de femmes, nous sommes conscientes que nos résultats sont approximatifs. Comme principaux biais, il faut relever que :
- la parité n’a pas été prise en compte dans le groupe témoin ;
- la maternité des HUG reçoit toutes les femmes et toutes les pathologies ;
- « Bien Naître » ne reçoit que les femmes qui ont une grossesse physiologique et qui choisissent d’avoir un accouchement avec le moins d’interventions médicales possible.
Le tableau ci-dessous montre que c’est à la maternité qu’il y a le plus haut taux de péridurales et de césariennes. Les deux sages-femmes de l’Arcade qui ont accepté de recueillir des données concernant péridurales et césariennes auprès de leurs patientes en post-partum sur une durée de quinze jours ont des données qui ressemblent à celles de la maternité, car leurs patientes sortent de cette institution en grande majorité. L’on remarque que les taux les plus bas de péridurales et de césariennes se trouvent dans le groupe « Bien Naître ». Les femmes qui ont suivi la PAN dans le cadre de notre enquête ont aussi des taux de péridurales et de césariennes moins élevés que ceux de la maternité.
| Nb de femmes | PAN effectuée | Péri. | César. | |
| Maternité | 4213 | ? | 85 % | 28 % |
| SF Arcade 1 | 28 | 16 | 93 % | 29 % |
| SF Arcade 2 | 12 | 12 | 83 % | 17 % |
| PAN Pro-Phy (enquête) | 33 | 33 | 60 % | 18 % |
| Bien Naître | 15 | -* | 13 % | 6 % |
Réponse à notre question…
Pour utiliser le ton qui est de mise quand on donne les résultats d’une étude, nous répondrons que… ni oui ni non : la PAN axée sur l’accouchement uniquement (sans parler ni de grossesse, de post-partum ou d’allaitement) participe peut-être à la diminution du taux de péridurales et de césariennes.
Une remarque corollaire qui apparaît dans cette recherche, ce sont les résultats de « Bien Naître » qui mettent en évidence une fois de plus l’importance d’un suivi continu.
… et recommandations
Issues des interviews appliquées pendant les rencontres postnatales et des lettres que nous ont écrites les participantes, des recommandations variées ont émergé :
- le plan de naissance pourrait comprendre aussi une réflexion sur la provocation, la césarienne, la péridurale ;
- plus de « pratique » est souhaitée et moins de « théorie », celle-ci pouvant être dispensée sous forme de documents. Par « pratique », les parents entendent surtout les jeux de rôles ou l’expérimentation de positions, relaxations, respirations. Une liste des lieux où s’effectuent diverses pratiques corporelles est souhaitée (shiatsu, yoga prénatal, etc.) ;
- la séance de PAN à domicile est très appréciée, elle pourrait faire partie intégrante des programmes de PAN ;
- l’accompagnement à domicile par la sage-femme qui a dispensé les rencontres de PAN, en début de travail ou par téléphone au moins, est souhaité par plusieurs participantes ;
- le suivi du post-partum par la sage-femme qui a dispensé les rencontres de PAN est aussi un élément retenu comme positif par les participantes.
Références
Cercle Qualité « Pro-Phy » (2017) Chers parents, vous avez le choix, Arcade Sages-femmes. Genève
De Gasquet, B. (2010) Trouver sa position d’accouchement. Paris, Marabout Santé Forme.
Hodnett, E. (2008) Continuity of caregivers for care during pregnancy and childbirth. Cochrane Database Syst. Rev. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10796108
Leboyer F. (1980) Pour une naissance sans violence. Paris, Seuil.
Leboyer, F. (2006) L’art du souffle. Ed. Dervy
Maffi, I. (2014) Les cours de PAN dans une maternité suisse. Entre logiques institutionnelles, postures des sages-femmes et autonomie des couples. In: Accompagner la naissance. Terrains socio-anthropologiques en Suisse romande. Collection A contrario Campus.
Enkin, M., Keirse, M., Neilson, J., Crowther, C., Duley,L., Hodnett, E. & Hofmeyr, J. (2000) A guide to effective care in pregnancy and childbirth. Oxford University Press, New York.
Vuille, M. (1998) Accouchement et douleur. Une étude sociologique. Lausanne, Antipodes.

De g. à dr. en bas : Eugenia Weimer, sage-femme, Céline Bergoz, sage-femme et cofondatrice de la maison de naissance La Roseraie, Véronique Spinnler, accoucheuse à domicile.
De g. à dr. en haut : Viviane Luisier, sage-femme cofondatrice de l’Arcade et ex-sage-femme agréée « Bien Naître », Ana Bela Gallo, sage-femme agréée « Bien Naître », Ivana Cerovaz, sage-femme préparatrice à la naissance. Toutes ces sages-femmes font partie de l’Arcade et font de la préparation à la naissance.
© D.R.


