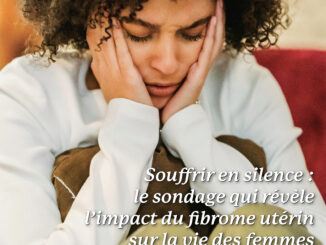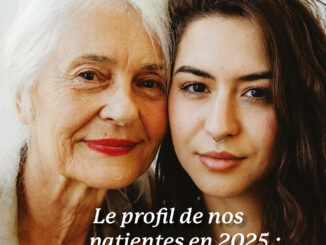Infertilité – PMA à 40 ans – Préservation sociétale : quand l’espoir se trouve en Espagne
Au-delà de la progression de l’infertilité elle-même (un couple sur quatre en France), nous avons identifié deux causes majeures à ce changement de paradigme : Profession Sage-Femme a assisté au 11e congrès international IVI RMAdu 24 au 26 avril 2025 à Barcelone. Ce rendez-vous a rassemblé 1 400 professionnels, chercheurs et académiciens de 58 pays pour aborder les avancées les plus prometteuses dans le domaine de la médecine reproductive. Nous avons profité de cette invitation du groupe de cliniques de la fertilité espagnol IVI, pour faire le point sur l’innovation scientifique en matière de fertilité et de PMA, et mettre à jour les connaissances sur les conditions de traitement et d’accueil des patients dans les centres de fertilité espagnols. Informer nos patientes bloquées dans le système français De plus en plus de patientes viennent en cabinet libéral pour des demandes de parcours de PMA. Nous pouvons les accueillir pour les renseigner, prescrire les premiers examens, faire les échos de monitoring d’ovulation et de datation, et les orienter vers un service d’AMP (assistance médicale à la procréation). Mais quand est-il de nos patientes qui n’arrivent pas à trouver de place ou sont sur des listes d’attente à rallonge dans les hôpitaux français ? À qui l’on dit que c’est trop tard ? Qui sont en échec à répétition ? Ou dont les spécificités ne sont pas prises en compte par la loi française ? La PMA hors frontière est une option pour elles. D’abord parce qu’elles auront la chance – si bien orientées – d’arriver à devenir maman ou à trouver une façon de s’adapter à ce qui les en empêche plus rapidement, ensuite parce que la Sécurité sociale prend en charge une partie des coûts importants d’une telle procédure à l’étranger. Les professionnels de santé français eux-mêmes envoient certains de leurs patients en Espagne. Les différences entre un pays comme...